par Bernard Davidou
Les ” vacanciers ” de la maison voisine étaient arrivés depuis deux jours déjà et ils ne s’étaient pas encore rencontrés.
Côté estivants, les premières journées avaient été consacrées à décompresser et prendre possession de cette grande maison ancienne, louée meublée au vu des photos qui insistaient sur le ” barbecue ” et la salle de bain, mais ne disait rien du charme du ” bolet ” et de l’escalier avec ses grandes marches de pierre à l’ombre de la treille.
Côté autochtone ou agriculteurs de la ferme la plus proche, ces jours de juillet étaient occupés par les moissons et les foins que l’on rentre sous la menace des orages et qui, avec les soins aux bêtes deux fois par jour, font les jambes lourdes et les reins douloureux quand la famille se réunit le soir, tard, pour le dernier repas.
La conversation s’établit gauchement le troisième jour quand l’estivant prit le prétexte de s’enquérir du point de ravitaillement le plus proche. Par la suite il prit l’habitude de se fournir en produits frais auprès de ses voisins à qui il rendait visite à l’étable, au moment de la traite manuelle du soir. De jour en jour, ce contact avec l’étable, les bêtes, lui procurait de plus en plus de plaisir.
Il découvrait les vaches qui, dans un impressionnant mouvement de cornes, arrachaient le foin du râtelier fixé au mur, sous la trappe par laquelle l’agriculteur l’avait fait tomber de l’étage supérieur.
Il caressait les veaux qui tirant sur leur chaîne, appelaient leur mère dans l’attente impatiente de la tétée. Un soir il s’amusa du va et viens des hirondelles qui nichaient contre une poutre du plafond, parmi les toiles d’araignées, et il observa un moment leur manège. Il s’enivrait de l’odeur forte et chaude de la grange et lorsqu’il rentrait au gîte rural, sa femme exigeait qu’il se douche avant de passer à table.
C’est ainsi que l’employé parisien vanta les avantages de la vie au grand air, libre et responsable, proche de la nature. Il l’opposa au travail ” en miettes ” qu’il subissait dans l’enfer bruyant de la capitale.
Par pudeur il s’abstint d’évoquer la menace de restructuration dont son service était l’objet. Il s’enquit, avec tact, du prix du bétail, des céréales et des rapports que les terres pouvaient donner. Il laissait un long silence entre chaque question et son interlocuteur lui était reconnaissant de marquer ainsi l’importance et le respect que l’on doit à l’argent qui est si dur à gagner.
Plusieurs fois, l’homme de la terre voulut répondre et parler des commodités de la ville, de la certitude du salaire en fin de mois, des aléas de l’agriculture et de l’élevage, de l’augmentation du prix du carburant , bref de la régression constante du revenu agricole … mais son manque d’assurance dans les longues phrases et la surveillance des bêtes l’empêchaient de s’exprimer autrement que par des monosyllabes.
Désormais la rencontre des deux hommes, en fin de journée, dans l’étable, était devenue une habitude quotidienne. Ils avaient plaisir à se retrouver comme s’ils étaient amis depuis toujours. De jour en jour, la conversation de l’estivant se fit de plus en plus libre. Un soir il développa son rêve de retour à la terre, ses projets : des animaux, une petite maison avec une grande cheminée, un jardin, une chèvre, un âne …
L’agriculteur sourit et acquiesça par politesse. Il songea avec nostalgie à l’affiche sur le mur de la mairie, qui, lorsqu’il avait vingt ans, avait failli changer le cours de sa vie parce qu’elle vantait les avantages d’une carrière dans la gendarmerie …
Après avoir visité tout ce qui était répertorié dans le dépliant du syndicat d’initiative, vint le jour du retour vers la capitale.
Les deux amis trinquèrent aux vacances finies avec du ratafia, produit naturel par sa fabrication, dont une bouteille servit de cadeau souvenir.
On se dit au revoir après avoir échangé adresse et numéros de téléphone, au cas où l’agriculteur trouverait enfin cet automne le temps de faire la visite au salon de l’agriculture dont il avait envie depuis longtemps.
Lorsque la voiture eut disparu au bout du village, il regarda successivement les deux maisons fermées et celle de son voisin célibataire qui, avec la sienne, constituaient le hameau où il avait toujours vécu. Il se dit qu’il avait eu une belle vie. Il souhaita que, lorsqu’il ne serait plus là, quelqu’un vienne, une fois par an habiter sa maison.
Bernard DAVIDOU octobre 1987
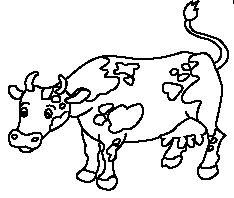
Laisser un commentaire