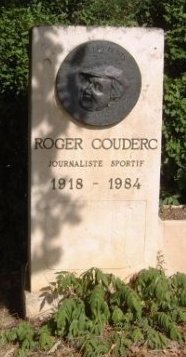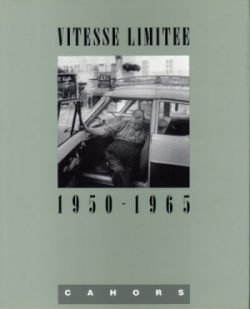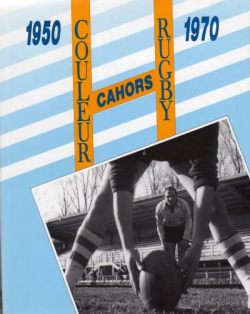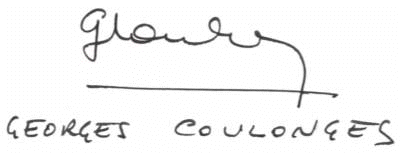Jean-Jacques Chapou, une figure importante de la résistance dans le Lot
 Jean-Jacques Chapou naît le 10 avril à Montcuq où ses parents, instituteurs, ont été nommés quelques années auparavant. C’est en troisième qu’il entre au Lycée Gambetta. Ses études secondaires finies, il se destine à l’enseignement : d’abord comme maître d’internat (1935-1936), puis comme professeur-adjoint (1937-1938). On le retrouve répétiteur, de 1938 à 1939 et de 1940 à 1941.
Jean-Jacques Chapou naît le 10 avril à Montcuq où ses parents, instituteurs, ont été nommés quelques années auparavant. C’est en troisième qu’il entre au Lycée Gambetta. Ses études secondaires finies, il se destine à l’enseignement : d’abord comme maître d’internat (1935-1936), puis comme professeur-adjoint (1937-1938). On le retrouve répétiteur, de 1938 à 1939 et de 1940 à 1941.
Mobilisé en 1939, il part pour Annot, petit village dans les Basses-Alpes. Dès 1940, il participe à quelques combats qui s’engagent à la frontière avec les soldats de Mussolini. Après l’armistice, il est démobilisé. Le 29 juillet 1940, il rejoint Cahors. A la fin de l’année 1941, il est renvoyé de l’Éducation Nationale par le gouvernement de Vichy, en raison de son appartenance à la franc-maçonnerie. A la recherche de travail, il devient secrétaire, en décembre 1941, au Groupement des Transports Routiers du Lot.
Au cours de l’hiver 1941-1942, Chapou entreprend de mettre sur pied la Résistance dans le Lot. Ce premier groupe veut former un syndicat clandestin tout en noyautant les syndicats officiels. Bientôt la Résistance touchera une part croissante de la population ; ainsi de 1942 à 1943, divers mouvements voient le jour.
Chapou devient le chef départemental du mouvement « Libération » dès septembre 1942. Il utilise son récent emploi de chef de service des autobus, à la maison Artigalas, à Cahors, comme moyen de reconnaissance continue de la région : il projette en effet d’élargir son mouvement.
Les autorités vichyssoises éprouvent une défiance grandissante envers ce fonctionnaire révoqué. Suite à une instruction ouverte contre lui, il est condamné par un tribunal spécial à Agen le 10 mars 1943, à un an de prison avec sursis. Le 8 juillet 1943, il quitte Cahors et rejoint le maquis d’Arcambal dit « France ». Il prend le nom de « Capitaine Philippe » et participe aux coups de mains, aux sabotages…
En 1944, il fait adhérer ses maquis aux Francs-Tireurs-Partisans, pour plus de coordination. Sabotages de voies ferrées, occupations de villes (Cajarc, Gramat…).

Route d’Eymoutiers, à la sortie de Bourganeuf (Creuse), le mémorial à J.-J. Chapou (Photo C. Laroche, Mémorial GenWeb)
Lorsque « Philippe » reçoit l’ordre de l’état-major supérieur des F.T.P. (3) de quitter le Lot pour prendre le commandement militaire des F.T.P. de la Corrèze, il abandonne son pseudonyme pour celui de « Kléber ».
Le dimanche 16 Juillet 1944, à Bourganeuf, pris dans une embuscade, il préfère la mort au déshonneur.
Le Lycée Gambetta, à Cahors, lui rend un dernier hommage le 18 décembre 1944 :
« Le corps de Jacques Chapou vint au parloir faire sa dernière halte. Couvert de drapeaux, entouré d’un amoncellement de fleurs, venues de tous les coins du Quercy, l’héroïque Capitaine Philippe… fut glorifié au cours d’une cérémonie grandiose où la population unanime honora une des plus hautes et des plus pures figures de la Résistance en Quercy » Discours de M. R. Saissac. Proviseur du Lycée. Distribution des Prix du 12 Juillet 1945.
Copie de la Citation de Jacques CHAPOU :
Par délégation du Commandant en chef des F.F.I., le colonel Rousselier, commandant la 12e Région Militaire, cite à l’ordre de la division à titre posthume, Chapou Jacques (Kleber), Capitaine, avec le motif suivant :
« Officier de haute valeur, d’une bravoure admirable. A organisé la Résistance dans le Lot, puis en Corrèze. A participé à de nombreuses actions contre l’ennemi. Directeur militaire de la Région Corrèzienne, a attaqué sans répit l’adversaire avec ses bataillons de patriotes. Combats de Tulle, Brive, d’Ussel. Directeur de l’inter-Région B, le 16 juillet 1944, est tombé dans une embuscade à Bourganeuf (Creuse). Blessé mortellement, a déchargé son revolver sur les Allemands et s’est achevé de sa dernière balle ».La présente citation comporte l’attribution de la Croix de guerre à étoile d’argent.
Sophie VILLES, La Mémoire Vive, Cahors, 1998.
Les maquis
La transformation des refuges pour réfractaires ou résistants pourchassés en maquis s’est faite au fur et à mesure de l’arrivée sur le terrain de responsables à l’esprit offensif et de la disponibilité d’un armement minimal.
Dès 1943 les maquis s’organisent eux aussi en groupes francs. Les hommes vivent en totale clandestinité et sont mobilisés à plein temps. L’Armée secrète compte fin 1943 les maquis suivants :
– maquis Timo, du 1er avril 1943 à janvier 1944;
– maquis Bessières, du 15 février 1943 à février 1944;
– maquis France, du 3 mai 1943 à février 1944;
– maquis Caniac, du 15 juin 1943 à février 1944;
– maquis Douaumont, du 15 juin 1943 à février 1944;
– maquis Imbert, du 15 novembre 1943 à février 1944;
– maquis Liberté, du 15 novembre 1943 à février 1944;
– maquis République, du 15 novembre 1943 à février 1944;
– maquis Vayssette (Figeac), du 1er octobre 1943 au 15 juin 1944;
– maquis La Figuerade, du 1er mars 1943 au 30 octobre 1943.
C’est Jacques Chapou, « Philippe », qui assure la coordination de l’ensemble. Au titre de l’Armée secrète ? Au titre des M.U.R. ? La confusion est extrême. C’est sûrement au titre des deux, la distinction entre action armée et action civile n’étant pas très claire. Lorsque la direction de l’A.S.. est forte, les maquis sont A.S. Lorsque le commandement A.S. est mis en cause certains maquis se disent M.U.R.
Il est illusoire de vouloir coller une hiérarchie du type classique au-dessus des maquis. Les hommes des maquis ne connaissent que leur chef de maquis et ceux-ci sont farouchement indépendants et n’admettent pas qu’on leur impose un cadre rigide.
Seul Chapou est admis par tous d’emblée. Son rôle est d’ailleurs tout en nuances. Il est l’exemple à suivre, le conseiller écouté, d’instinct accepté.
Il ne s’agit pas de monter des opérations d’envergure mais d’orienter les actions au coup par coup. Sans état-major, avec un ou deux complices, Chapou est bien à la fin de 1943 le meneur de jeu des maquis, choisi d’instinct par tous.
Les maquisards de l’Armée secrète.
Un ouvrage, écrit par des amis très proches de Philippe, Georges Cazard et Marcel Metges, paru en 1950, retrace d’une façon magistrale le destin de ce grand résistant.
L’admiration qui l’entoure, la confiance qu’il inspire le poussent encore plus à se démarquer de l’A.S. et des M.U.R. Un rendez-vous manqué avec Collignon et Verlhac lui donne à penser à une mise à l’écart. C’est dans cet état d’esprit que se trouve Philippe lorsque, début 1944, le parti communiste lance une offensive d’envergure pour s’implanter en tant que tel dans la résistance lotoise.
Pour le P.C. ramener vers lui les militants communistes qui agissent au sein des divers mouvements est facile. Mais cela ne suffit pas, il lui faut récupérer tout ce qui est valable chez les autres. Philippe est un objectif de choix. « Récupérer » Philippe c’est aussi faire main basse sur les maquis A.S. et grâce à « Georges », communiste, chef du maquis Bessières depuis peu, s’installer en force dans ce département plutôt anticommuniste. Philippe hésite longtemps puis, vers le 15 janvier 1944, accepte.
Quinze jours après l’acceptation de Philippe, les groupes « Francs-Tireurs Partisans » émergent dans le Lot; le 15 février, la plupart des maquis A.S. ou M.U.R. passent aux F.T.P. avec armes et bagages, et en mars 1944 le triangle de direction F.T.P. est constitué :
– commissaire aux effectifs : Georges;
– commissaire technique : Gaston;
– commissaire aux opérations : Philippe.
L’éclatement des maquis A.S., M.U.R. ou S.-Vény qui fait suite au changement d’orientation de Jacques Chapou n’est que le prologue d’une longue action menée par les F.T.P. pour prendre en main la Résistance lotoise. Un résultat positif pour les A.S.-Vény est quand même enregistré. Les groupes gagnent en homogénéité et en esprit d’équipe ce qu’ils ont perdu en hommes et en armes.
[…]
Ombres et espérances en Quercy, (Armée secrète le Groupe Vény du Lot 1940-1945), Les Éditions de la Bouriane, Gourdon, 1999.