Certains lieux apparaissent, plus que d ‘autres, marqués par l ’empreinte de l ‘histoire : la ville de Souillac en fait partie et il n ‘est, pour s ‘en convaincre, que de s ‘attarder devant l ‘imposante abbatiale Sainte-Marie, comme le fit jadis l ‘historien d ‘art français, Émile Mâle, avant de l ‘évoquer, avec le talent qu ‘on lui connaît, dans des pages de la Revue des Deux Mondes devenues mémorables. Cet édifice, qui suscite aujourd ‘hui encore l ‘admiration des touristes et dont deux absidioles détruites par les huguenots furent rebâties en 1841, soutient (pour le moins) la comparaison avec les cathédrales de Cahors, de Périgueux ou d ‘Angoulême. Mais s ‘il fascine à ce point, ce n ‘est pas seulement pour des raisons esthétiques, c ‘est parce qu ‘il représente, d ‘une manière éclatante, le passé de la cité. Tous les événements importants ont gravité en effet autour du monastère (Xe siècle) et de son abbatiale qui sera achevée en 1150, en pleine période de splendeur pour la cité et pour la communauté religieuse. Souillac s ‘épanouit sous cette autorité ecclésiastique et, dépendant, pour le pouvoir temporel, de la vicomté de Brassac, elle devient ville royale en 1253.
Au XIIIe siècle, c ‘est une belle cité féodale, entourée de remparts qui sont flanqués de tourelles, avec cinq portes et un pont-levis qui s ‘abaisse, chaque matin, pour laisser passer les cultivateurs et les mariniers : un centre urbain animé, où marchands, artisans et hommes de loi s ‘affairent, à l ‘ombre de la citadelle protectrice (église fortifiée, grosse tour qui permet de surveiller les environs et monastère qui dispense un enseignement gratuit). Le pouvoir local, vers lequel se sont acheminés paisiblement les Souillagais, se partage entre la commune et le monastère, sous l ‘autorité du seigneur, doyen puis abbé. L ‘agriculture est prospère et les petits métiers nombreux, mais tout change lors de la guerre de Cent Ans – les registres des villes de Martel, Gourdon et Cajarc sont éloquents à ce sujet – et l ‘on doit alors songer avant tout à la sécurité de la ville, aux assauts des ennemis qu ‘il faut repousser, aux portes et aux remparts que l ‘on doit réparer, aux moyens de racheter la cité quand elle est aux mains des Anglais. Le traité de Brétigny (1360), catastrophique pour le Sud-Ouest de la France, provoque de nouveaux combats (1367-1373) et il faudra beaucoup de temps pour revenir à une vie paisible. A la fin du XVe siècle, le monastère est érigé comme abbaye et Souillac, redevenue prospère, est un véritable centre d ‘approvisionnement.
Les guerres de religion remettent toute cette belle harmonie en cause et Souillac, « point stratégique », est au cœur des batailles, de 1562 à 1613. En 1653, la ville, tombée aux mains des frondeurs, sera délivrée par les troupes royales. Il faudra à Mgr de la Mothe-Houdancourt plus d ‘un demi-siècle pour restaurer l ‘abbaye, mais la foi et le dynamisme économique seront les plus forts jusqu ‘en 1789 et même pendant la Révolution « la masse des habitants reste catholique ». Dans cette vaste fresque historique, apparaissent aussi les viaducs et la Forge, Bourzolles et Saint-Étienne-Lacombe, Cazoulès et Lanzac, Pinsac, les châteaux de la Treyne et de Belcastel et les grottes de Lacave, « l ‘une des deux plus grandes curiosités souterraines d ‘Europe ».
Archives : Livres Page 38 of 51
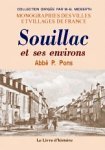

Le présent ouvrage nous permet de redécouvrir le passé des communes entre Souillac et Saint-Céré, riches en sites pittoresques, en événements et en personnages.
La découverte d ‘importantes pièces archéologiques dans les grottes de Lacave, telles des pointes de flèche, des burins de silex et des poignards, est le témoignage des premières manifestations de l ‘écriture. L ‘auteur nous signale aussi les vestiges des civilisations anciennes, comme ceux de la ville celtique de Puy d ‘Issolud il nous fait également redécouvrir les merveilles de l ‘architecture comme le cloître de Martel, chef-d ‘oeuvre de la Renaissance, ou encore Rocamadour, qui figure parmi les plus belles villes médiévales avec le château des évêques qui couronne le village.
L ‘auteur nous relate les événements douloureux qui éprouvèrent le pays, comme Martel qui fut pillée et détruite pendant les guerres de la Réforme. Enfin, nous découvrons tout au long du récit les personnages qui prirent part aux événements tel Philippe le Hardi qui assura l ‘indépendance de la bastide de Tauriac vis à vis des très puissants seigneurs, les vicomtes de Turennes. Cet ouvrage ne pourra que passionner tous les amateurs d ‘histoire locale.

Point stratégique pour la navigation sur le Lot, Puy-l ‘Evêque doit son importance à son siège épiscopal créé au XIIIe siècle. L ‘histoire de cette région, toute hérissée de châteaux et d ‘abbayes, offre une lecture passionnante, celle-là même proposée par Charles Deloncle dans son ouvrage publié en 1867 que nous rééditons ici.
Au XIIIe siècle, la ville de Puy passa donc sous la domination de l ‘évêque de Cahors et un siècle plus tard, elle prit le nom de Puy-l ‘Evêque. Ce fut Barthélémy de Ruffi qui fit des travaux aux portes de Luzerche, Bélaye, Puy, afin d ‘améliorer la navigation sur le lot. En 1271, il accorda une charte de franchise et de privilèges aux habitants.
En 1348, le sire de Pestillac et l ‘armée anglaise ravagèrent la ville et ses environs. Puy resta un siècle sous leur domination, et son enceinte fut agrandie afin de contenir une nombreuse garnison. Les Anglais construisirent une église en 1495. Elle fut incendiée pendant les guerres de religion. En 1580, 140 coups de canons furent tirés par l ‘armée de François de Caumont-la-Force, calviniste, contre ses murs.
Des origines au XIXe siècle, l ‘histoire de Puy-l ‘Evêque passionnera incontestablement tous les amateurs d ‘histoire locale.
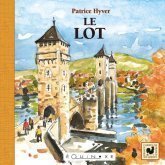
« Avant la découverte de Christophe Colomb, écrit l ‘auteur au début de son ouvrage, le sauvage Péruvien vivait pauvre sur des mines d ‘or et foulait aux pieds, sans le savoir, les richesses de deux mondes. Nous serait-il permis d ‘adresser à nos Compatriotes le même reproche d ‘ignorance, non sur des trésors matériels que leur sol ne produit pas, mais eu égard aux richesses morales qu ‘il a vu naître ? »
Et tout le livre fourmillant d ‘informations de ce docteur en médecine passionné par l ‘histoire du Lot nous montre que ce département a engendré de tout temps des hommes de courage et de talent ; aussi nous retrace-t-il la biographie de plus de 500 personnages qui ont marqué, par leurs actions et par leurs oeuvres, leur époque et leur région d ‘origine.
Chaque notice qu ‘il leur consacre est précise et détaillée et tous les articles sont classés par ordre alphabétique. Nous y trouvons des artistes, des artisans, des hommes politiques, des soldats, des marins, des ecclésiastiques, des savants, des juristes…
Guillaume Calmon, par exemple, avocat notoire, Pierre Séguiers, né à Figeac en 1510, orateur et écrivain, Galiot de Genouillac, qui devint chambellan et grand écuyer de France, ou l ‘inventeur Lagarouste, né à Saint-Céré, ou encore Anne Besse, dite Anneton de Poupon, née à Cahors en 1722, d ‘abord connue pour ses charmes, puis pour ses vertus religieuses. Et combien d ‘autres, tout aussi prestigieux et utiles à la collectivité dont ils faisaient partie.
Un ouvrage de référence pour quiconque veut connaître réellement l ‘histoire du département du Lot.

Antique village formé avant l ‘occupation romaine, Gramat fut une puissante baronnie pendant le Moyen Age. Son passé, tumultueux comme celui du Quercy, nous est dévoilé à travers cet ouvrage de Jean Balagayrie. L ‘auteur fait revivre les quatre grandes familles de seigneurs qui possédèrent la terre de Gramat sous l ‘Ancien Régime : les Castelnau, les d ‘Aigrefeuille, les d ‘Auriolle et les Foulhiac, et rappelle l ‘existence de Hugues Ier de Castelnau, vers 950. Il explique quelle fut l ‘organisation du bourg et son évolution à travers les âges : il évoque l ‘érection de Gramat en commune, en 1224, l ‘administration des consuls qui s ‘ensuivit et la construction du premier hôtel de ville, en 1365.
Il relate l ‘épisode douloureux de la guerre de Cent Ans, qui eut pour première conséquence l ‘appauvrissement du domaine. Nous retrouvons les lieux empreints de souvenirs, telles l ‘église Saint-Pierre, et les rues du Moyen Age, dont l ‘auteur nous livre les noms. Enfin, nous redécouvrons les faits marquants de la Révolution : par exemple, les émeutes provoquées par les mesures anti-religieuses.
Jean Balagayrie a tiré de l ‘oubli les événements et les personnages qui firent le passé de Gramat. Le présent ouvrage ne peut que passionner tous les amateurs d ‘histoire locale.
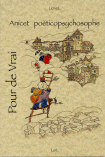
Anicet est un petit personnage qui s ‘est posé sur un coin de ma table à dessin un jour par hasard à St Cirq Lapopie.
C ‘est une petite bouille ronde qui estime qu ‘il n ‘est pas sans conséquence de laisser venir les théoriciens des névroses picorer dans nos assiettes nos petits restes de libertés.
(De temps à autres sa route croise celle de « Bigousse » Citoyen du monde ; Une figure de genre humanimal, fétiche de l ‘association Art et Citoyenneté dont le but est de faire connaître,
entretenir et vivre le Route Mondiale sans frontière.)
Si chacun a son petit paradis quelque par, celui d ‘Anicet est à St Cirq Lapopie.
L ‘album de 60 pages contient 30 réflexions avec des mots pour sourire et 30 reproductions de dessins aquarellés peints avec une plume trempée dans l ‘encre de l ‘humour.
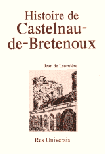
La baronnie de Castelnau se rangeait parmi les plus beaux fiefs du Midi. Les origines de son château se perdent dans les ombres de la légende. Lieu de faste au XVIIe siècle, il fut abandonné pour Versailles. Napoléon III voulut l ‘acquérir, mais il lui préféra finalement Pierrefonds. Telle est l ‘histoire passionnante que relate Jean de Laumière dans son ouvrage, le « Château de Castelnau et ses seigneurs », qui fut publié en 1901.
On apprend la légende de la fondation de l ‘église Saint-Spérie: au VIIe siècle, Hélidius de Castelnau voulait épouser Spérie qui refusa, afin de se consacrer à Dieu. Après l ‘avoir retrouvée, il la décapita et ô miracle, elle ramassa sa tête pour la laver dans l ‘eau, et là, frappée à nouveau, elle mourut.
On visite les fondations du château bâties par la reine Brunehaut : elles mesuraient 13 à 17 mètres de hauteur, et étaient flanquées de 9 tours. On assiste au siège de la ville en 1159 par Henri II roi d ‘Angleterre. On apprend que les barons de Castelnau suivirent les comtes de Toulouse lors de la croisade contre les Albigeois.
Enfin, après la mort du dernier Guilhem à Paris en 1705, le château, non entretenu, se désagrégea progressivement. La Révolution brisera ses écussons, et en 1851, un incendie achèvera la destruction des bâtiments.
De la gloire à la ruine, les lecteurs retrouveront avec émotion l ‘histoire de Castelnau et de son château.
CASTELNAU-DE-BRETENOUX (Histoire de)
par Jean de Laumière
La baronnie de Castelnau se rangeait parmi les plus beaux fiefs du Midi. Les origines de son château se perdent dans les ombres de la légende. Lieu de faste au XVIIe siècle, il fut abandonné pour Versailles. Napoléon III voulut l ‘acquérir, mais il lui préféra finalement Pierrefonds. Telle est l ‘histoire passionnante que relate Jean de Laumière dans son ouvrage, le « Château de Castelnau et ses seigneurs », qui fut publié en 1901.
On apprend la légende de la fondation de l ‘église Saint-Spérie: au VIIe siècle, Hélidius de Castelnau voulait épouser Spérie qui refusa, afin de se consacrer à Dieu. Après l ‘avoir retrouvée, il la décapita et ô miracle, elle ramassa sa tête pour la laver dans l ‘eau, et là, frappée à nouveau, elle mourut.
On visite les fondations du château bâties par la reine Brunehaut : elles mesuraient 13 à 17 mètres de hauteur, et étaient flanquées de 9 tours. On assiste au siège de la ville en 1159 par Henri II roi d ‘Angleterre. On apprend que les barons de Castelnau suivirent les comtes de Toulouse lors de la croisade contre les Albigeois.
Enfin, après la mort du dernier Guilhem à Paris en 1705, le château, non entretenu, se désagrégea progressivement. La Révolution brisera ses écussons, et en 1851, un incendie achèvera la destruction des bâtiments.
De la gloire à la ruine, les lecteurs retrouveront avec émotion l ‘histoire de Castelnau et de son château.
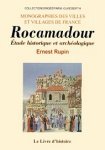
Aujourd ‘hui, les très nombreux visiteurs de Rocamadour, les pèlerins qui gravissent plus de 200 marches pour accéder à l ‘oratoire de la Vierge – autrefois, on les montait sur les genoux – les touristes épris d ‘esthétisme, comme les Amadouriens eux-mêmes, communient dans une admiration unanime pour la belle cité : pour ce « site extraordinaire, ensemble de monuments de tout âge aussi digne d ‘attirer l ‘attention des artistes que de retenir la curiosité des archéologues ». E. Rupin évoque ce qui a fait de deux imposantes masses rocheuses taillées à pic, « tout un amoncellement de maisons, d ‘églises, de chapelles, de couvents adossés à la muraille calcaire, creusés dans le roc, ou abrités sous des rochers en surplomb ». Tout ayant commencé par le culte fervent rendu à la Vierge, dès le Moyen Age, matérialisé par un pèlerinage qui a traversé les siècles et engendré une communauté humaine, un habitat spécifique, des édifices militaires, civils et religieux et de nombreuses activités.
Historien rigoureux, l ‘auteur distingue, à propos des origines (et de saint Amadour) ce qui revient à la légende et ce qui appartient à la réalité. Ensuite il évoque avec une grande richesse d ‘informations la création du pèlerinage, en général, et la naissance de celui de Roc-Amadour, en particulier. Il relate aussi tous les événements qui se sont déroulés dans la ville, du Xe au XIIIe siècle (luttes entre les abbés de Tulle et de Marcillac et guerres entre le roi d ‘Angleterre et ses fils), rappelle la célébrité de la Vierge de Roc-Amadour dans l ‘Europe entière, la prospérité de la cité, les incursions des Anglais et des routiers, les affrontements entre catholiques et protestants et la Révolution qui « passa à Roc-Amadour comme un torrent furieux ». Toutefois, après le Concordat, Roc-Amadour appartient de nouveau au diocèse de Cahors, mais sans réserve d ‘un droit quelconque pour les évêques de Tulle.
Après quoi, l ‘auteur revient, dans un long et passionnant développement, sur le pèlerinage fondateur, qui pouvait être, autrefois, volontaire ou obligatoire et dans ce dernier cas, imposé par l ‘autorité ecclésiastique ou par l ‘autorité civile et il termine par un panorama archéologique amadourien, militaire, civil et religieux : avec la description des rues et des portes, du château et des fortifications, des vieux remparts et de la maison Bergougnoux, de l ‘épée dite de Roland, des peintures murales, des chapelles et des églises et de la statue de la Vierge.
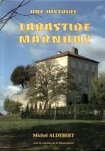
Quand on ne sait pas où l ‘on va, peut-être est-il utile et même nécessaire de savoir au moins d ‘où l ‘on vient…
Cette première monographie du village de Labastide-Marnhac, qui s ‘efforce de rendre compte de bientôt huit siècles de son histoire, peut aider à trouver quelques unes des clefs qui régiront son devenir !

On ne présente plus Christian Rapin tant il est connu pour son œuvre aussi éclectique que savante et à la portée de tous ceux qui sont concernés par la langue occitane ou s ‘y intéressent ainsi que pour son action militante efficace et discrète au sein de diverses associations ou dans le quotidien.
On connaît déjà le romancier, le poète, I ‘essayiste, le grammairien, le lexicographe et le critique qu ‘il est. Ceux qui l ‘apprécient pour l ‘avoir approché ou qui le côtoient savent avec quelle ténacité et quelle régularité exemplaire il écrit et publie, malgré le labeur qu ‘il s ‘impose, le dictionnaire Français-Occitan. Il prépare déjà le tome V.
Mais nous voudrions présenter le quatrième concernant les lettres de H à M incluses. Aussi riche que ceux qui l ‘ont précédé. S ‘adressant à un public qui, dans son immense majorité, a été éduqué, depuis les premiers mots prononcés, en français, ce dictionnaire vise à la promotion de la langue. Il cite neuf cents auteurs et trois mille ouvrages. C ‘est dire les recherches qu ‘a dû faire l ‘auteur pour être pragmatique et exhaustif. Il est plutôt normatif sans pour autant négliger les synonymes toujours utiles aux écrivains et à ceux qui sont à l ‘affût de néologismes.
Si le dictionnaire rend compte en priorité de la langue actuelle il ne passe pas sous silence la diachronie qui affecte les mots. Ils évoluent au rythme de la vie.
L ‘auteur n ‘hésite pas à mentionner des mots souvent censurés dans d ‘autres dictionnaires et à citer le vocabulaire des techniques de pointe (fibrociment, trinomi, quimioterapia, gonococ, lopidoptèr).
Les racines gréco-latines ou bibliques qui ont façonné notre culture occitane y sont premières mais les anglicismes et les germanismes ne lui sont pas étrangers (bunker = bloc, bastion, casamata, reduch, avançada).
Evidemment, le dictionnaire n ‘oublie ni le parler branché ou populaire, ni les exclamations et les onomatopées, ni les dictons et les proverbes si importants pour une langue parlée et qui expriment l ‘âme d ‘un pays.
Enfin, le dictionnaire permet souvent de passer du niveau synthétique à l ‘analytique.
Nous n ‘avons retenu ici que quelques-uns des grands mérites de ce travail de bénédictin qu ‘il est convenu d ‘appeler désormais: » le Rapin « .
Il est l ‘œuvre d ‘une vie.
Tous ceux qui auront recours à ce dictionnaire diront merci à son auteur pour ce labeur de choix qui a demandé beaucoup de temps, de compétence et d ‘amour pour la langue et la culture occitanes. Ils attendent, avec impatience, la parution du 50 tome, I ‘avant-dernier, de cet important ouvrage qu ‘on ne pourra pas ignorer dans l ‘avenir.
André MATEU
Publié dans la Revue de l’Agenais d’octobre 2003, Académie des Sciences, Lettres et Arts, Agen 2003

ANALYSE d¹après la revue Patrimoine Midi-Pyrénées n°2 (janvier 2004) :
Cet ouvrage réunit les interventions présentées au colloque organisé à
Rennes en février 2002 sur les enjeux d¹une reconnaissance des langues
régionales ou minoritaires par I¹État français. Tandis qu ‘Henri Giordan et
Tangi Louarn évoquent « l¹impuissance politique » française à ¦uvrer
significativement en leur faveur, le témoignage précis de Francesco de Renzo
nous montre comment et combien l ‘État italien agit en faveur de ses
minorités linguistiques : grâce à une nouvelle loi, I ‘école prévoit
expressément que les langues minoritaires doivent être non seulement
enseignées, mais aussi enseignantes à côté de l ‘italien. Grâce à la même
loi, toutes les initiatives collectives sont soutenues significativement,
jusque dans les médias.
Si certains intervenants entrevoient les « bonnes dispositions » du
ministère de la Culture, d ‘autres ne manquent pas de rappeler que la
Commission européenne renvoie quant à elle l ‘Etat français à « toutes » ses
responsabilités en faveur de ses langues. En ménageant toutes les frilosités
institutionnelles françaises, Henri Giordan tente alors de dessiner un
cheminement possible, à travers les mailles de la Constitution républicaine
française, vers la sauvegarde des langues minoritaires, grâce à un
enseignement bilingue immersif, seul capable en l¹état actuel d¹en préserver
l¹usage.
Après la lecture de cet ouvrage entièrement tourné vers I ‘Europe, ses
institutions et sa diversité, nous restons désorientés : si ni la
Constitution, ni les ministères, ni le droit national ou international ne
s ‘opposent aux langues minoritaires, comment expliquer que la fameuse »
frilosité » française sur cette question suffise à bloquer considérablement
l ‘émancipation légitime de toutes nos langues ? Ne manque-t-il pas aux
langues de France une volonté politique claire de sauvegarde et de
transmission ?
Franck Bardou

Contribution de : Michel Banniard, Xavier Ravier, Geneviève Hasenohr, Jacques Mourier, Dominique Javel, Pierre Jolibert, Florence Mouchet-Chaumard, Maryvonne Spiesser, Pierre Escudé, Jean-François Courouau, Jean Eygun, Catherine Valenti, Philippe Gardy, Catherine Brun-Trigaud, Lucia Molinu, Xarles Videgain.
Ce volume offre un panorama riche et varié des études réalisées sur les langues méridionales. L ‘ouvrage traite aussi bien des structures linguistiques de langues d ‘oc et d ‘oïl, des manuscrits occitans du XIVe siècle, que de l ‘usage et des pratiques de la langue d ‘oc au travers de la célébration de la messe, ou des oeuvres musicales du XVe au XVIIIe siècles. La littérature occitane est abordée sous divers angles, grâce aux romans de François Salvaing, à la poésie ou encore aux chants royaux en occitan gascon.
D ‘autres articles analyseront ces langues méidionales dans une perspective historique ; la volonté de l ‘affirmation de l ‘identité française sous la IIIe République (enseignement du français au Pays basque) ou le rôle de la référence provençale dans l ‘idéologie de l ‘Action française.
Enfin, ce livre propose un atlas linguistique du Pays basque.
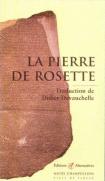
La célèbre Perre de Rosette, actuellement exposée au British Muséum de Londres, fut découverte en juillet 1799 par le lieutenant Xavier Bouchard, membre de l ‘expédition de Bonaparte en Egypte. Après quinze siècles d ‘oubli, cet élément contribua grandement au déchiffrement de l ‘écriture des anciens Egyptiens, et avec d ‘autres documents, permit à Jean-François Champollion de réinvestir cette écriture.
De tous temps, l ‘écriture égyptienne a fasciné les créatifs. Voici un ouvrage qui nous permet de revenir sur l ‘histoire de la pierre de rosette. Le Musée Champollion de Figeac (Lot), possède une oeuvre commandée à l ‘artiste Joseph Kosuth qui rend hommage à ce savant et a travaillé sur une nouvelle traduction qui a été demandée à l ‘égyptologue Didier Devauchelle. C ‘est ainsi qu ‘est né l ‘Ex-Libris J.-F.Champollion qui se trouve au musée. Cet ouvrage nous raconte l ‘histoire de la pierre et nous ramène aux origines de cette découverte qui nous a permis de décrypter ces images signifiantes que sont les hiéroglyphes.
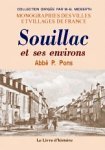
Ville étape au carrefour d ‘un fleuve, la Dordogne, de l ‘itinéraire de Paris à Toulouse et de la voie de chemin de fer joignant les mêmes villes, Souillac s ‘est depuis longtemps consacrée au commerce, à l ‘accueil des voyageurs. La proximité de sites prestigieux, (Rocamadour, Sarlat, Martel) draine un afflux de visiteurs séduits par la beauté de la région.
Dans cet ouvrage, l ‘auteur s ‘est attaché à retracer la riche et très ancienne histoire de Souillac et de ses environs immédiats. Ses propections ont enrichi la connaissance de ce passé, en particulier pour les périodes les plus reculées.

L ‘amour…
Stendhal, Sacha Guitry, Jacques Brel, Tolstoï, Benjamin Constant, Oscar Wilde, Sigmund Freud, l’abbé Prévost, Michel Houellebecq, Serge Gainsbourg, Balzac, Stéphane Ternoise…
Nous n’avons quand même pas tant écrit sur une illusion, une simple aspiration, l’inaccessible.
Soit, l’Amour n’existe pas, nous devons à chaque fois l’inventer…
Un essai bilan, sur l’étendue du possible… et en sortir en état de se comprendre un peu mieux, se croire encore capable de réaliser ce miracle…
180 ans après Stendhal, son essai De l ‘Amour, Stéphane Ternoise s ‘intéresse à ce surprenant sentiment… Et présente la sérénamour…
La sérénamour ? L ‘Amour serein en aspirations similaires. L ‘Amour troisième millénaire ?
Amour… est le septième livre de Stéphane Ternoise

