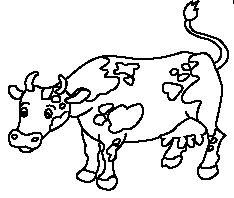(La double citoyenneté)
Nos parents se marièrent en mille neuf cent quarante deux et se séparèrent douze ans plus tard. La mésentente régnait depuis longtemps déjà et les querelles continuèrent longtemps après, sous des formes différentes telles que lettres, commandements, etc …
Notre Père, blessé en Belgique le fût une seconde fois dans la poche de Dunkerque d’où il fût l’un des derniers évacués avant l’arrivée des allemands. Ancien combattant pensionné de guerre, il fût nommé en cinquante quatre » receveur buraliste » à Caillac.
Il avait obtenu après un concours cet » emploi réservé » qui, du paysan qu’il était avant, le transformait en commerçant contractuel de l’administration, chargé de vendre les produits du monopole de la SEITA et d’établir les titres de transport, les états des stocks de vins et alcools dans ce village. Il l’avait choisi alors qu’il aurait pu prendre le poste de Moncuq, plus important et mieux payé. Son choix avait deux raisons. Il restait proche de Calamane oû résidait notre Mère et nous pouvions ainsi aller de l’un à l’autre facilement à vélo. Enfin il comptait sur le temps libre que lui laisseraient des responsabilités moins importantes, pour continuer à mener une activité agricole dans cette vallée alluvionnaire plus riche que le causse.
Ma sœur et moi n’avions plus » des parents « comme les autres enfants de notre age mais un Père et une Mère, qui essayèrent chacun de son côté de recréer un nid dans lequel ils nous accueillaient, à tour de rôle, avec tout l’amour et la sécurité d’un foyer uni. Nous étions chanceux et nous eûmes deux fois plus que les autres. Nous eûmes aussi la double citoyenneté Caillacoise et Calamanaise et l’occasion de nous faire des copains que nous retrouvions lors des vacances scolaires.
Il y avait les petites vacances que constituaient toussaint, noël et paques. Elles étaient si courtes qu’elles ne nous laissaient que le temps de souffler et se refaire des forces avant d’attaquer le prochain trimestre.
Le mois de juillet nous ramenait de nos pensionnats cadurciens, toulousains ou figeacois et nous avions hâte de nous revoir. Nous nous rassemblions au bord du lot pour la baignade et nous décidions de l’endroit ou nous installerions, sur la berge droite de la rivière, un plongeoir qui deviendrait l’œuvre de l’été et notre bien commun. Lorsque ce choix était fait, nous nous répartissions les tâches et tout naturellement Guy prenait la direction des opérations :
– Bernard tu apporteras le marteau et les pointes.
– Dédé tu nous trouveras une scie et des pinces,
– Christian … René …Jacky …
Plusieurs fois, notre travail fut interrompu par l’arrivée courroucée de mon Père ou un autre, qui, après une sieste plus courte que prévu, cherchait son outil pour continuer son bricolage, à l’ombre de sa grange. Nous trouvions quelques planches réformées, un peu de fil de fer et une semaine plus tard, en quelques après-midi, le travail était presque terminé, jamais totalement fini, du moins pouvions nous utiliser le plongeoir qui avançait sur la rivière à un endroit ou la profondeur de l’eau permettait nos prouesses acrobatiques !
En fait d’exploits, je parle surtout des autres. J’avais appris à nager tardivement avec mon Père qui par sécurité m’attachait à la cheville avec les » rennes » du mulet pour me permettre de m’exercer à la cale. Encore une fois, Guy était le meilleur et ses plongeons laissaient les filles les yeux ronds et rêveurs… Comme dans toutes les bandes de jeunes il y avait des filles autochtones et d’autres, exogènes, à l’accent pointu. On les appelait » les vacancières « ou » les Parisiennes « avant de connaître leur prénom. Il y avait deux catégories de vacancières qui par trois vagues successives, juillet, août et septembre, habitaient notre village.
Les » vacancières de chez NADAL « , résidaient avec leurs parents en pension chez Fernand et Sylvaine qui tenaient l’hôtel restaurant qui existe toujours. Je me souviens de la surprise de Sylvaine la première fois qu’en début de mois elle servit l’apéritif à quelques jeunes de la commune dont l’objectif n’était pas éthylique mais de voir les nouvelles arrivées…
Il y avait enfin les vacancières logées chez l’habitant qui, aidé par des primes conséquentes, avait restauré un appartement indépendant dans sa maison (comme mon Père) ou une bâtisse inoccupée. Les papas de ces demoiselles allaient à la pèche toute la journée. Les mamans tricotaient ou papotaient à l’ombre devant la fontaine sous la garde attentionnée de Sylvaine, et, souvent les filles rejoignaient notre bande ou des amourettes ne tardaient pas à éclore.
Mon Père, était une force de la nature. Sanguin, torse nu tout l’été, toujours souriant et actif, il a gardé plus de vingt ans un mulet avec lequel il travaillait quelques lopins de terre et sa vigne. Il vendait du vin, des fraises, des haricots et d’autres légumes. Il engraissait parfois quelques animaux, pour un petit bénéfice et le fumier nécessaire à ses cultures. Pour eux il allait faucher » ses prés longs « . Il appelait ainsi les banquettes des routes qu’il rasait de très prés avec sa grande faux qu’il m’a appris à piquer et utiliser.
Une année, il conclut avec Fernand NADAL un contrat qui lui permettait de récupérer, chaque jour, les restes du restaurant avec lesquels il élevait trois ou quatre porcs dont il partageait le bénéfice avec ce dernier. Chaque soir nous allions récupérer les fonds de plats ou assiettes que les clients avaient dédaignés ou pas pu achever (le restaurant avait très bonne réputation) et que les serveurs vidaient dans une grande poubelle.
Les affaires marchaient très bien et je revois encore mon Père fier de ses bêtes et de leurs progrès, leur parlant comme à des enfants, à qui il autorisait tous les soirs une récréation dans la cour fermée de sa maison. Un matin cependant les porcs refusèrent de se lever et avaient perdu cet appétit qui faisait la joie de leur maître. Nous eûmes peur d’une épidémie foudroyante et étions prêts à demander le secours du vétérinaire lorsque, fouillant avec un bâton dans la poubelle à nourriture, mon Père trouva tous les babas au rhum que Sylvaine avait préparés le jour précédent pour un groupe de clients qui s’était décommandé au dernier moment. Après avoir bien ri de les voir dans cet état, nous laissâmes nos porcs jeûner et attendre le changement de menu. Avec les revenus de ses diverses activités, prenant prétexte de ma réussite au bac, il m’acheta une barque neuve.
A cette époque, le Lot était poissonneux. L’été les vacanciers avaient chacun leur » trou « . On appelait ainsi un coin de berge que le pécheur aménageait en coupant les branches gênantes, en égalisant la terre au-dessus du niveau de l’eau de façon à pouvoir installer confortablement ses cannes et poser son siège pliant. Fernand NADAL qui, comme sa Sylvaine avait le sens commercial, en entretenait plusieurs qu’il réservait d’une année à l’autre à ses meilleurs et fidèles pensionnaires.
Fascinés par la rivière, les » caussenards « que nous étions étaient friands de ses produits. Mon père tenta plusieurs fois d’aller pécher avec une mouche qu’il faisait danser au bout de son bambou, depuis la barque. Après avoir laissé quelques hameçons dans les branches basses des arbres qui retombaient sur l’eau, il décida qu’il n’était pas fait pour cette activité et abandonna. Avec Guy nous avons essayé de braconner des écrevisses dans le ruisseau ou des anguilles dans le lot, qui en comportait encore quelques-unes. Pour cela je laissais faisander une tête de mouton dans un coin de la grange de mon Père. Quand elle était bien grouillante d’asticots et odorante, nous nous en servions comme appât dans des nasses ou des balances.
Le succès tardant à venir et mon Père ayant trouvé un moyen de nous approvisionner en poisson frais, j’abandonnais très vite. Les vacanciers qui allaient prendre leur quart à surveiller leur bouchon passaient devant notre maison quatre fois par jour. Ils s’approvisionnaient en gauloises, gitanes ou tabac gris et nous faisions connaissance. Comme ils ne pouvaient pas consommer les poissons qu’ils attrapaient, ils nous les laissaient et nous nous régalions de carpes arc-en-ciel ou autre menu fretin plein d’arêtes mais à la chair savoureuse et ferme.
Mon père avait beaucoup d’amis dans la commune. Le plus pittoresque était Antonin qui arrivait en criant » Minonoum Davidou ! » et dont on percevait l’odeur fauve dés qu’il s’approchait à moins de trois mètres. Il jouait de la clarinette et avait eu, dans sa jeunesse un certain succès en animant seul des bals interdits pendant la guerre ou des mariages. Il travaillait comme journalier chez ceux qui le demandaient, … beaucoup au printemps et en été un peu en automne, rarement en hiver, saison au cours de laquelle il avait souvent faim et froid dans sa maison dont le toit laissait voir un trou parmi les tuiles rouges. Lui ayant demandé s’il ne pleuvait pas sur son lit, il me répondit qu’il l’avait poussé dans un coin de la pièce encore protégé par ce qui restait du toit.
Parfois, à la mauvaise saison mon Père avait pitié de lui et l’invitait à partager son repas. Antonin s’asseyait devant son couvert prenait l’assiette à soupe entre ses doigts sales et la reniflait avec bruit. Invariablement il décrétait « cô put lou fresqun ! « et d’un geste ample et circulaire de son coude il l’essuyait avec le revers de sa veste. Il était toujours de bonne humeur et colportait les nouvelles de chez l’un chez l’autre sans trop de discernement.
Parce qu’il avait dit des choses qui ne plaisaient pas au Père Boussac, celui-çi l’avait menacé de faire tomber le rocher qui, quelques mètres plus haut, dominait sa maison. Antonin, qui était craintif, avait passé quelques nuits seul dans les coteaux avec sa clarinette et une bougie qui clignotait le soir tandis que parvenait la mélodie de quelque chanson démodée. Lorsqu’il eut soixante cinq ans il eut droit à une petite pension, partie de retraite ou fonds national de solidarité, qui lui permit de s’acheter un poste à transistor et de vivre enfin les plus belles et dernières années de sa vie.
Parmi les amis de mon Père il y avait aussi Mme et M. Montet. Ils s’échangeaient des services et tous les ans pour la fête de Caillac, qui avait lieu le premier dimanche après le quinze août, Mme Montet nous faisait un massepain, gâteau dont la tradition s’est perdue dans notre quercy. Ce jour là malgré la chaleur de l’été, mon Père allumait le four de la cuisinière pour cuire le rôti qui lui permettrait de recevoir la famille de son frère et celle de sa sœur. Je me souviens d’un été ou, bien qu’il n’ait pas fait anormalement chaud, les mouches avaient envahi la maison, malgré les pulvérisations de » Fly-tox « et les serpentins collants.
En ouvrant son four pour le nettoyer en prévision du rôti à cuire, mon Père eut la désagréable surprise d’y trouver … une tête de mouton qui datait de mes aventures piscicoles de juillet.
Les fêtes constituaient la seule occasion de nous divertir et de sortir car il n’y avait ni télévision ni boite de nuit. Leur cycle était immuable d’une année à l’autre : Il commençait par celles de Laroque des arcs ou Pradines et se terminait par celle de Luzech le huit septembre. Pour les amateurs il y avait, dans un genre plus authentique et sylvestre, la foire du Dégagnazes qui a lieu le neuf septembre.
Nous nous y retrouvions le samedi soir, le dimanche en matinée et soirée. Les plus acharnés ou amoureux, sortaient aussi le lundi soir. Nous avions des mobylettes bleues et je garde la nostalgie des longues chevauchées en compagnie de mon grand copain Dédé, des pannes dans la campagne obscure, lorsqu’il fallait remettre la chaîne en place pour achever d’arriver au bal ou … siphonner du mélange dans un réservoir ami pour pouvoir revenir chez nous à trois heures du lundi matin. Dédé nous a quitté bien trop tôt hélas.
Le » point d’orgue » de nos vacances se situait lors de la fête de Caillac qui avait lieu, comme je l’ai déjà dit, au milieu de celles-ci. Tous les jeunes savaient danser et dés les premières mesures de l’accordéon ou du saxophone, les garçons invitaient leur cavalières que parfois ils arrachaient à la garde de la maman. Lorsque l’on avait fait connaissance, le garçon proposait une promenade hors de la lumières gênante des lampions. Chacun avait son » truc « , plus ou moins original ou attractif. J’en connais un , dont par charité (bien ordonnée …) je tairai le prénom, qui proposait une promenade en barque sur le Lot.
Les adultes que nous sommes devenus pourraient penser que ce » truc « , qui avouons le, sentait fortement la préméditation, était voué à l’échec. L’aspect romantique de la proposition, l’emportait largement sur toute autre considération et, même les soirs de fête sans lune, le » truc « , (qui ne faisait pas » crac, boum hue « comme celui de Dutronc) lui permettait de beaux succès auprès de caussenardes qui rêvaient de Venise et son grand canal ou de parisiennes libérées par l’ambiance des vacances.
Un dimanche soir de fêtes cependant, l’aventure faillit tourner au drame. La barque, mal calfeutrée prenait l’eau et la Juliette se rappelant à temps qu’elle ne savait pas nager exigea un retour précoce et peu glorieux pour son Roméo d’un soir qui en garde un souvenir fait plus de regrets que de frayeurs.
Le lundi de la fête était plus calme. L’après-midi avait lieu la traditionnelle course au canard sur le lot et après la fin du bal, vers les trois heures du mardi matin, Sylvaine servait le réveillon aux jeunes du comité. Les deux événements étaient liés, comme on va le voir.
Lors de mes vingt ans j’étais » conscrit » et donc membre de droit du comité des fêtes ou je retrouvais toute la bande de garçon et filles. Monsieur Singlande, seul adulte parmi nous, représentait, avec discrétion, la caution du conseil municipal. Sylvaine nous avait promis de nous préparer le traditionnel réveillon à condition que nous lui fournissions trois canards. Il fut assez facile de trouver auprès des Caillacois et nos familles cinq canards que nous devions lâcher lors de la course aux canards. Nous pensions récupérer facilement au moins les trois nécessaires à notre réveillon.
Quand nous apprîmes le lundi matin que les jeunes de Douelle avaient décidé de venir tenter leur chance l’après-midi, Guy décréta l’état d’urgence. A deux heures il semblait plus confiant mais ne voulait rien dire de plus que » laissez moi faire ».
A cinq heures, sur la berge de la cale, la musique chauffait une foule de spectateurs insouciants qui nous applaudirent lorsque nous arrivâmes, derrière notre chef portant nos cinq volatiles qui semblaient bien décidés à éviter le réveillon. Voyant que nos voisins, en tenue de bain, s’apprêtaient nous disputer celui-ci, Guy, notre meilleur espoir au crawl, dit avec gravité :
– La situation est grave, faites pour le mieux, c’est moi qui lancerai les canards à l’eau quand j’atteindrai le milieu du lot avec la barque.
Stupéfaits de voir leur meilleur espoir renoncer à concourir, les Caillacois firent silence. Alors qu’il arrivait à une petite moitié de la largeur de la rivière, Guy posa les rames, détacha le premier canard et après avoir discrètement cogné la tète du volatile sur le fond de la barque il le lança vers l’un des nôtres qui s’empressa de l’attraper, avant qu’il ne coule comme un caillou, sous les applaudissements de la foule et les coups de cymbale des musiciens. Il en alla de même du second et des murmures commençaient enfler du côté de nos voisins. Le troisième canard me tomba dans les bras et j’eu l’adresse de lui éviter la noyade.
Après quoi, fier de la mission accomplie et en grand seigneur il détacha lentement les pattes du quatrième palmipède qu’il jeta, bien vivant, au milieu de la rivière après un baiser d’adieu sur la tète. Il y eut du spectacle et de l’imprévu car personne ne se doutait que le bestiau était capable d’établir des records d’apnée. Se débattant en laissant quelques plumes dans les mains avides des nageurs qui croyaient le tenir, il virait à quatre-vingt-dix degrés, plongeait et restait un long moment sous la surface tandis que nos concurrents se demandaient, pendant d’interminables secondes, quelle sorcellerie le faisait disparaître à droite alors qu’il réapparaissait en caquetant et battant furieusement des ailes à gauche de la barque.
Bref, il réussit à gagner les joncs de la berge et fut perdu pour tout le monde. La musique joua » de profoundis « et Guy lança le dernier canard devant un jeune de Douelle qui eut tôt fait de l’attraper sous des salves d’applaudissements, dont une partie seulement lui étaient destinés. L’honneur était sauf et Sylvaine, dont la buvette avait beaucoup travaillé cette année, nous prépara un bon réveillon.
Il n’y a plus de course au canard à Caillac, et la vie a dispersés la plupart de nous, André nous a quittés, mon Père repose dans le champ de Mr Pévré qui est devenu le nouveau cimetière ou tous ses amis l’ont accompagné une dernière fois en quatre vingt seize. A côté de sa maison de marbre se trouve celle des Montet. Lorsque je vais lui faire une visite, je pense que les vivants qui l’ont connu ont une pensée pour lui quand ils vont se recueillir auprès des leurs. Il est entouré des champs qu’il a travaillés et il surveille sa vigne qui est à quelques mètres de son caveau.
Je sais aussi que ceux qui ont fait leur vie hors de Caillac, Gervais, Nicole, Jean-Pierre, Guy, Jean, Suzy,… sont propriétaires, dans ce village, de souvenirs qui leur donnent droit, comme moi, à une double citoyenneté.
Bernard DAVIDOU
réécrit en 02/2005
(premier texte en 96 » La double citoyenneté « ).