Femmes outragées ! Femmes brisées ! Femmes martyrisées ! Mais femmes libérées !
D’essence gaullienne, cette formule parodique reflète assez bien le lent et douloureux cheminement qui tout au long des siècles a conduit nos compagnes jusqu’au statut qui leur est conféré aujourd’hui. Un parcours qui mériterait une vaste et passionnante étude, mais mon projet faute de temps et de moyens ne peut être aussi ambitieux en dépit de la présence dans les silos des Archives Départementales de nombreux documents susceptibles d’en constituer la trame. Je voudrais simplement, avec la compassion qui leur est due, rendre hommage à toutes ces femmes – nos aïeules – en évoquant les souffrances qui leur firent sexuellement cortège, au moyen de deux ouvrages, le premier intitulé « Rapts de séduction », le second « Rapts de violence ».
Il s’agit d’une entreprise délicate étant donné la nature du sujet à traiter. Mieux vaut sans plus attendre inviter les âmes sensibles ou exagérément pudiques à préférer la lecture des œuvres de la comtesse de Ségur. Première difficulté : avant même de commencer un problème s’est posé à moi : devais-je nommément citer les personnes qui furent impliquées dans les cruelles et souvent ignominieuses affaires dont il va être question ou me résoudre à n’utiliser que leurs initiales, au prétexte de ne pas froisser l’amour propre de leurs descendants ? A ceux-là, je voudrais dire que nul n’est débiteur des égarements de ses aïeux et que se contenter de les désigner par leurs seules initiales, outre le fait d’édulcorer le récit, pouvait avoir l’inconvénient d’engendrer de pernicieuses suspicions. Tout bien pesé j’ai opté pour la clarté au motif que tout être humain, selon un aphorisme bien connu des généalogistes, possède parmi ses ancêtres au moins un prince et un pendu, et rappeler que de célèbres affaires – Calas, Fualdès, Seznec, Dreyfus, Landru, Petiot, et tant d’autres – ont toujours été évoquées par les noms de leurs protagonistes et pas autrement. Je dirai encore à l’intention des grincheux – il va bien s’en trouver – que les documents d’archives publiques concernant la justice sont librement consultables et légalement utilisables à l’expiration d’un délai de cent ans à compter de la date de l’acte ou de la clôture du dossier.
En conséquence de quoi, dans l’intérêt des chercheurs auxquels cet ouvrage est avant tout destiné, j’ai usé consciemment de ce droit, dans le strict respect des obligations qu’il comporte.
Catégories Librairie : Histoire - Documents Page 13 of 20
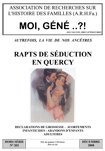
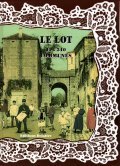
Réunies dans un seul volume, de la plus petite à la plus grande, toutes les communes du département du Lot, avec au minimum une illustration (souvent une carte postale ancienne). Sur chacune des commu-nes : nom des habitants, noms anciens, populations à différentes époques, superficie, altitudes (minimales et maximales), quelques faits historiques, monuments anciens et actuels, église, châteaux, manoirs, approche du petit patrimoine, chapelles, lavoirs, pigeonniers, croix an-ciennes, curiosités diverses, principaux personnages nés ou décédés dans la commune, description des armoiries, artisanat et industrie, sites touristiques, manifestations…

Fouillé en 2000 dans le cadre des opérations d’archéologie préventive préalables à la construction de l’autoroute A20 dans le Lot, le site des Bosses à Lamagdelaine constitue un apport significatif à la connaissance des plus anciennes manifestations du Paléolithique
moyen européen. Les analyses multidisciplinaires
présentées ici dans une vision dynamique viennent
enrichir opportunément un corpus de données encore peu fourni sur ce sujet. Datée des stades isotopiques 9 ou 8, l’industrie lithique offre des caractères originaux, attribuables pour partie à son ancienneté, mais aussi au contexte lithologique spécifique du Quercy où les quartz et quartzites sont largement dominants. Une véritable économie des matières premières a pu être mise en évidence, permettant d’avancer dans la réflexion sur les modalités d’occupation d’un territoire tel que la moyenne vallée du Lot.
Les études rassemblées dans cet ouvrage s’inscrivent dans des perspectives résolument modernes et renouvelées de la recherche
préhistorique, de la géoarchéologie à la technologie lithique, et pose un jalon supplémentaire de la perception du Paléolithique
moyen ancien dans le Sud-Ouest de l’Europe.

30 millions d ‘années de biodiversité dynamique dans le paléokarst du Quercy.
Journées Bernard Géze
Lalbenque-Limogne 1-3 octobre 2005
TABLE DES MATIERES
Préface
Avant-Propos
ASPECTS HISTORIQUES, ETHIQUES, ENVIRONNEMENTAUX
E. BUFFETAUT :
La « ruée vers les phosphates » du XIXème siècle : une aubaine pour la paléontologie des Vertébrés crétacés
M. DURAND-DELGA :
De la découverte des phosphorites du Quercy au renouveau de leur étude avec Bernard Gèze
F. DURANTHON & F. RlPOLL :
Documents photographiques inédits d ‘Eugène Trutat sur l ‘exploitation des phosphorites du Quercy
E. MAUDUIT :
Les phosphatières du Quercy : état des lieux et mesures de protection au titre de l ‘archéologie
TH. PÉLISSIÉ :
Risques de pollution de l ‘aquifère karstique par les anciennes décharges sauvages dans les
phosphatières du Quercy
PALEOBIOLOGIE
M.AUGE :
Répartition de taille chez les lézards des Phosphorites du Quercy
J. CLAUDE & H.TONG:
Les faunes chéloniennes fossiles du Quercy : mise à jour des connaissances
J.-Y. CROCHET, J.-P. AGUILAR, J. G. ASTRUC, N. BOULBES, G. ESCARGUEL, J. MICHAUX, S. MONTUIRF, TH. PÉLISSIÉ, R. SIMON-COINÇON & B. SIGÉ :
Reprises plio-pleistocènes du paléokarst quercinois
D. DE FRANCESCHI, C.-LE GALL, G, ESCARGUEL, M. HUGUENEY, S. LEGENDRE, R. SIMON-COINÇON, TH. PÉLISSIÉ & B. SIGÉ :
Une paléoflore des phosphatières du Quercy (Sud Ouest France) : première découverte, résultats et perspectives
B. LANGE-BADRÉ :
Quelques caractères morpho-fonctionnels du membre antérieur de petits mammifères carnivores d ‘Aubrelong 1 (Oligocène inférieur, Lot, France)
E. MAITRE, M. HUGUENEY, J. G. ASTRUC, J.-Y. CROCHET, G. ESCARGUEL, M. GODINOT, S. LEGENDRE, B. MARANDAT, C. MOURER-CHAUVIRÉ, J.-C. RAGE, J. A. RÉMY, R. SIMON-COINÇON, J. SUDRE, P. VALETTE & B.SIGÉ:
Huit nouvelles faunes éocènes et oligocènes des phosphorites du Quercy
G. MAYR & C. MOURER-CHAUVIRÉ :
An anusual avian coracoid from thé paleogene Quercy fissure filiings in France
C. MOURER-CHAUVIRÉ :
The avifauna of thé Eocene and oligocene phosphorites du Quercy (France) : An updated list C. MOURER-CHAUVIRÉ & B. SIGÉ :
Une nouvelle espèce de Jungornis (Aves, Apodiformes) et de nouvelles formes de Coraciiformes s.. dans l ‘Eocène supérieur du Quercy
J.-C. RAGE :
The lower Vertébrales from thé Eocene and Oligocène of thé phosphorites du Quercy (France) : an overview
J. A. RÉMY& J. SUDRE :
L ‘apport des faunes du Quercy à la connaissance des grands mammifères
B. SIGÉ & J.-Y. CROCHET : Marsupiaux, insectivores s./., chiroptères, créodontes et carnivores paléogènes d ‘Europe décrits ou révisés d ‘après les nouvelles collections du Quercy (SW France)
B. SIGÉ & M, HUGUENEY :
Les micromammifères des gisements à phosphates du Quercy (SW France)
R, SMITH :
Le genre Euronyctia (Nyctitheriidae, Mammalia) en Europe occidentale
ASPECTS MACRO-ÉCOLOGIQUES
G. ESCARGUEL & S. LEGENDRE :
New methods for analysing deep-iime meta-community dynamics and their application to the paleogene mammals from the Quercy and Limagne area (Massif Central, France)
S. LEGENDRE, C. MOURER-CHAUVIRÉ, M. HUGUENEY, E. MAITRE, B. SIGÈ & G. ESCARGUEL :
Dynamique de la diversité des mammifères et des oiseaux paléogènes du Massif Central (Quercy et Limagnes, France)

Il y a quelques années, descendant vers midi la grande avenue de Cahors en quête d ‘une librairie qui vende un ouvrage consacré aux violences paysannes du début du XIXe siècle, je rencontrai sur le seuil de son magasin Je libraire ; quoique pressé de fermer boutique pour aller déjeuner, cet homme, sympathique et cultivé, voulut bien me servir et répondre à mes questions. Quand je lui fis par! de mon projet de travailler sur les Cent-Jours en Quercy et peut-être même sur une période un peu plus large, il me répondit, peut-être avec regret : « Bah !, ici, il ne s ‘est rien passé à l ‘époque qui vous intéresse… » Voici ma réponse à ce libraire… On pense sans doute, à Cahors et dans le Lot, qu ‘il n ‘y a rien à dire sur cette période et que tous les faits marquants se sont produits ailleurs, mais s ‘est-on donné la peine de consulter les abondantes et précieuses archives du département, des Archives nationales et des municipalités ?
J ‘ai également entrepris ce travail de recherche et de rédaction pour répondre, un peu tard ii est vrai, au souhait de notre regretté médiéviste, M. Jean Lartigaut, qui m ‘avait incité à travailler sur cette période historique, très mal connue parce qu ‘insuffisamment étudiée, qui va de la fin du Premier Empire à la Révolution de Juillet.
Comment ne pas trouver captivante une époque qui aura connu quatre « tremblements de terre » successifs, essentiellement dans les domaines militaire et politique, avec des soubresauts, répercussions et « répliques » dans toutes les manifestations et activités de la vie sociale ?
Premier séisme : Napoléon abdique en avril 1814 : c ‘est la fin du régime impérial, lui-même issu du système révolutionnaire.
Deuxième séisme : la première Restauration, qui ressuscite le gouvernement monarchique et ramène les Bourbons, dure moins d ‘une année et s ‘effondre en mars 1815 lors du retour triomphal de l ‘île d ‘Elbe de l ’empereur banni.
Troisième séisme : les Cent-Jours, qui voient renaître un système impérial plus libéral, se terminent par le désastre de Waterloo. Napoléon, qui a sollicité de se retirer en Angleterre, est exilé à Sainte-Hélène où il mourra en 1821
Quatrième séisme : Dans la foulée de Waterloo et à l ‘abri des baïonnettes étrangères, les Bourbons reprennent le pouvoir et rétablissent définitivement (du moins le croient-ils) la royauté en France
Chacun de ces changements brutaux dans la direction du pays s ‘accompagne évidemment de révocations, destitutions, déplacements du personnel dirigeant et de tentatives d ‘épuration de tout ce qui peut représenter une influence… Je dis bien « tentatives » car, en fait, beaucoup de maréchaux, généraux, ministres, évêques, préfets, sous-préfets, sénateurs, députés, artistes, ont senti Je vent tourner et se sont assuré des arrières. Sans avoir le moindre problème de conscience, reniant sans sourciller les serments prêtés hier au gouvernement en place, ils prêtent pleine allégeance à la nouvelle autorité, surtout si elle peut garantir les droits acquis, voire même leur assurer de nouveaux privilèges. Ce n ‘est pas pour rien qu ‘un des ouvrages les plus lus et appréciés à cette époque a été le fameux « Dictionnaire des Girouettes » d ‘Alexis Eymery où chacun pouvait reconnaître une personnalité bien en cour, dotée d ‘une extraordinaire flexibilité…
Je ne cacherai pas au lecteur que, parmi tous les documents, on ne peut plus officiels, qui me sont passés sous les yeux, certains donnaient des hommes une image si déplaisante que j ‘aurais préféré ne pas les trouver. D ‘autres, au contraire, me prouvaient qu ‘il suffisait parfois d ‘un individu au caractère ferme et bien trempé pour retourner complètement une situation critique… Que de fois n ‘ai-je pas constaté à travers l ‘abondante documentation des archives nationales, départementales et municipales que tel personnage influent, comblé d ‘or et d ‘honneurs par le régime en place, s ‘effondre lamentablement comme une loque à la première bourrasque venue, alors que tel individu du commun, sans appui, sans ressources ni relations, se comporte dans la tourmente en véritable capitaine, faisant face à la tempête et maintenant droit le cap et ferme le gouvernail…
Ceci est une relation honnête, non exhaustive mais forcément partielle d ‘événements, présentant selon moi un certain intérêt, survenus dans le Lot entre 1813 et 1830, de la fin du Premier Empire à la Révolution de Juillet. Chacun pourra éventuellement contrôler l ‘exactitude des faits avancés en se reportant aux références indiquées au bas de chaque paragraphe. Je me suis efforcé d ‘être impartial à l ‘égard des uns et des autres, mais l ‘est-on jamais. L ‘homme ne sera jamais parfaitement objectif : il a sa personnalité, sa sensibilité et sa conscience.
Je le dédie à la mémoire de Guillaume Aussel, mon plus lointain ancêtre paternel connu, humble travailleur de terre, demeurant, dans la première moitié du 18e siècle, à Graule Basse, paroisse de Carlucet, et à celle de mon arrière grand-père maternel, Jean Tapie, né le 3 germinal An XI de la République française (24 mars 1803) au village de Grandroques, commune de Linars, de Pierre Tapie, propriétaire, es de Marguerite Fourastié, son épouse. Agé de 10 ans lorsque débute mon récit. Jean Tapie en avait 27 en 1830 quand il prend fin ; lors de la Révolution de juillet, il servait comme fusilier au 9e régiment d ‘infanterie de ligne, apprenant avec le métier des armes celui de tailleur d ‘habits, état qu ‘il transmettra à son fils Pascal, mon grand-père maternel. Tout en étant contemporain des faits de cette courte période de 17 ans, si riche en bouleversements militaires et politiques, en a-t-il pris conscience ? : c ‘est fort douteux vu l ‘extrême modestie de son origine et le peu d ‘instruction qui fut probablement son lot comme celui de millions d ‘autres.
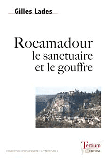
Rocamadour attire de toute l’Europe fidèles et pèlerins autour de son sanctuaire de la Vierge Noire, à mi-hauteur du grand rocher du Val d’Alzou. Ce ruisseau, qui a la particularité d’être intermittent, donne à la vallée des couleurs d’oasis.
Cette ville médiévale est secrètement entourée par un défilé, le “Val Ténébreux” et par deux gouffres en aval : Cabouy et Saint-Sauveur. Le second éveille plus particulièrement l’idée de l’insondable.
Ces lieux saisissants, générateurs d’expériences originaires comme l’effroi et la fascination, environnent d’étrangeté un sanctuaire conçu comme un théâtre de pierre qui magnifie les volumes initiaux du canyon et comme une pensée théologique invitant, à travers la riche histoire du pèlerinage, à une double postulation chrétienne : l’élévation et le recueillement.
Gilles Lades est né en 1949 à Figeac. Il vit et travaille dans le Lot. Prix Antonin Artaud 1994.
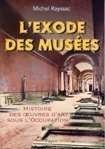
Histoire des collections françaises sous l ‘Occupation
Que sont devenus nos musées entre 1939 et 1945 ? Où était La Joconde en 1940 ? Quel sort ont connu les trésors artistiques de l’Alsace après l’armistice ? Ceux des collections particulières ?
Aux heures sombres et mouvementées de la guerre et de l’Occupation, des hommes et des femmes ont risqué leur vie pour sauver des dizaines de milliers de chefs-d’oeuvre. Les gardiens des dépôts réquisitionnés de l’Ouest et du Sud-Ouest doivent résister aux Allemands, aux bombardements comme aux intempéries ; les conservateurs des Musées nationaux, sous la houlette de leur directeur Jacques Jaujard, tiennent tête au gouvernement de Vichy et défient la sinistre Commission Rosenberg, qui traque, sur l’ordre d’Hermann Goering et avec la complicité de malfrats et de policiers véreux, les collections juives ; Rose Valland, conservateur au musée du Jeu de paume où sont entreposées les oeuvres spoliées, note en secret le contenu des caisses qui seront convoyées vers Berlin pour alimenter le futur et fantasmé musée du Führer…
Ces héros discrets et l’histoire des trésors artistiques qu’ils protègent nourrissent l’enquête minutieuse et inédite de Michel Rayssac, qui commence en 1938 en pleine guerre d’Espagne, se poursuit sur les routes mitraillées et encombrées de l’exode et s’achève avec la capitulation du Reich, dans l’Allemagne dévastée, au moment où les Alliés lancent leurs enquêteurs sur la piste du butin de guerre nazi.
Pour nous offrir cette chronique passionnante, Michel Rayssac, professeur retraité des écoles, a dépouillé inlassablement pendant quinze ans les archives de la Seconde Guerre mondiale, épluché les rapports de police, les correspondances administratives ou diplomatiques, fouillé les dossiers, consulté les journaux et interrogé les acteurs ou les témoins survivants.

Une grande famille de St Céré : les de PUYMULE. Révélations d ‘un terrier (17-18e s)
Cette publication est le fruit d ‘une série de petits miracles. Le premier réside dans la confection par Philippe François de Puymule, d ‘un registre où il relie les actes seigneuriaux anciens de sa famille ainsi que ceux qu ‘il a lui-même fait dresser entre 1642 et 1773. Manifestation d ‘une réaction féodale face aux juristes méridionaux qui affirment «pas de .seigneur- sans fifre » ou plutôt comme nous l ‘avons souvent observé dans le Figeacois à la même époque, désir d ‘en terminer avec d ‘innombrables procès ?
Second miracle, ce document a échappé aux destructions spontanées qui suivirent la déception de la nuit du 4 août, où il a été décrété que les droits dcigncuriaux réels seraient simplement rachetables et aux destructions organisées des titres remis en 1793 aux municipalités.
Troisième miracle, qui est aussi un clin d ‘ccil. il a été trouvé dans le grenier d ‘une maison de Figeac qui a été sans doute fréquentée par François Boutade, un Figeacois devenu professeur de droit à Toulouse et auteur d ‘un célèbre Traité des droits seigneuriaux et des matières féodales, qui connut plusieurs éditions dans la seconde moitié du XVHIieinc siècle.
Enfin, Guy Castéran, dont nous connaissons tous l ‘érudition, a eu la patience de dépouiller et d ‘analyser ce terrier et de situer géographiquement les biens concernés. C ‘est le grand intérêt de cette étude. Souvent il est impossible de dresser une cartographie des seigneuries car leur enchevêtrement et leur parcellisation sont constamment en mouvement. Qu ‘il en soit félicité !
Philippe CALMON

Si le nom sonore de Gambetta est familier aux Français, il n’évoque aujourd’hui pour beaucoup qu’une silhouette floue, s’échappant en ballon d’un Paris assiégé. Pourtant, le personnage mérite l’attention des curieux de l’histoire : n’a-t-il pas même la stature d’un héros de roman ?
Fils d’étranger, il se hisse au premier rang de l’actualité nationale, de 1868 à 1882. Ses
contemporains admirent en lui un génie oratoire, dont le verbe soulève les auditoires populaires plus encore que assemblées parlementaires. Mais c’est aussi un esprit politique de premier ordre. Face à l’invasion étrangère, en héritier des Conventionnels de l’an II, il conduit la résistance d’armées improvisées avec une énergie communicative. La paix retrouvée, il sait manoeuvrer dans un climat d’incertitude constitutionnelle et il arrache en définitive la fondation de la République.
Enfin, la publication de ses lettres, nombreuses et spontanées, complètent l’éclairage de ses
discours : sous le leader public, elle révèlent l’homme privé qui, comme tout autre, aime, se réjouit, souffre dans son for intime.
Pierre Barral a enseigné l ‘histoire contemporaine dans les universités de Nancy-II et de Montpellier-III (Paul Valéry). Dans ses recherches, il s ‘est particulièrement intéressé à la III7me République. Il a publié de nombreux ouvrages, dont une anthologie de textes, Les Fondateurs de la III7me Républiques (Armand Colin, 1968) et une biographie, Jules Ferry, une volonté pour le République (Presses Universitaires de Nancy, 1985).

Fénelon aurait pu devenir le Richelieu du nouveau siècle : son intelligence exceptionnelle et sa vision anticipatrice, la confiance que lui accorde le petit-fils de Louis XIV et futur Dauphin – le duc de Bourgogne – l ‘y préparent.
Les Aventures de Télémaque où le public voit une censure du régime font en quelques mois le tour de l ‘Europe ; la Lettre au Roi et l ‘ Examen de conscience rappellent avec audace leurs devoirs aux princes. Fénelon pense les droits des peuples en termes de solidarité ; il est l ‘anti-Machiavel : la morale, parce qu ‘elle est universelle, déborde la politique, et toute son oeuvre d ‘éducation est une critique indirecte de la façon de régner de Louis XIV.
Mais l ‘ambitieux prélat privilégie les chemins spirituels aux allées du pouvoir. Cette attitude paradoxale fut prise pour la posture d ‘un fier jouant les humbles ; elle lui valut la disgrâce royale, les foudres de Bossuet et l ‘exil à Cambrai, supportés comme autant d ‘épreuves sur la voie d ‘une quête personnelle. Vaincu fascinant ses contemporains, Fénelon est ainsi le seul personnage du Grand Siècle qui réchappa aux rayons du Roi-Soleil.
L ‘auteur : Historienne spécialiste de l ‘Ancien Régime, Sabine Melchior-Bonnet a notamment publié L ‘Histoire de l ‘adultère (Grand Prix des lectrices de Elle ), Catherine de Bourbon, l ‘insoumise et Louis et Marie-Adélaïde de Bourgogne, La vertu et la grâce.

Parler de la vie quotidienne à Martel dans la première moitié du dix-neuvième siècle ? Pourquoi ?
Hormis le livre de Marcel Baleste, on manquait jusqu’il y a peu, d’études sur Martel durant la Révolution et le dix-neuvième siècle. Le colloque organisé en août 2003 s’est efforcé de metttre l’accent sur la vie quotidienne envisagée sous plusieurs perspectives.
Tout d’abord les familles de notables qui régissent la vie municipale et s’y opposent autour d’idées nouvelles qu’illustre la création du journal Le Radical ; puis les données qui permettent d’en mesurer la richesse au travers d’inventaires, inexploités jusqu’alors, ou au vu des maisons qui sonnent à Martel une partie de son charme.
Il était plus difficile d’appréhender la vie des gens modestes. Pour s’en faire une idée, il a fallu interroger ce que l’on sait de leurs activités, de leurs métiers, et donner aux femmes la place qui est la leur.
L’enjeu réel du colloque, dont l’Association Rencontres et Patrimoine en Pays Martelais, créée depuis lors, publie les actes, visait, surtout, par l’examen de l’organisation municipale, de l’aménagement urbain, des modes de construction commentés par des artisans locaux, de l’enseignement, de la vie religieuse et de la place des femmes, à montrer comment les Martelais de la première moitié du dix-neuvième siècle concevait leur ville.
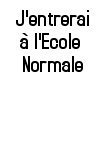
Martel au début du vingtième siècle a été un centre important de préparation au Brevet élémentaire et au concours d’entrée à l’Ecole Normale.
Comment deux adolescentes de milieu modeste ont-elles pu y suivre des enseignements et réussir ces difficiles épreuves ? Qu’elle a été leur vie entre 1903 et 1924 ?
Tel est l’objet du présent ouvrage qui réunit des souvenirs de Marie-Louise Souilhac et de Suzanne Requier, des extraits de lettres adressées à Marie-Louise et les résultats d’une recherche sur l’Ecole de Jeunes Filles de Martel.
Ces documents authentiques, inédits à ce jour, permettent de faire revivre une période, à la fois proche et lointaine, où « l’asenceur social » a bien existé. Des jeunes filles, ayant un « projet ferme et définitif » ont pu le mener à bien grâce à leur détermination, à leur travail, et à des enseignants d’exception.

L’histoire de Martel avait fait l’objet d’un premier livre qui conduisait le lecteur de la Révolution à la guerre de 1914. Mais il manquait à ce récit puisé aux sources des archives de la ville, un volet le rapprochant de notre période contemporaine.
Ce constat a conduit l’auteur à étendre ses recherches jusqu’aux prémices de la seconde guerre mondiale. Bien que les documents disponibles soient, sinon moins abondants, du moins plus anecdotiques parfois, il est parvenu à dresser de ce pan d’histoire, traversé par la tragédie de la guerre 1914-1918, mais aussi marqué par la modernisation de la vie quotidienne, un récit propre à rappeler le devenir d’un patrimoine auquel les martelais demeurent très attachés.
Marcel Baleste, agrégé de l’Université, professeur honoraire de classes supérieures au Lycée Henri IV de Paris, est issu d’une famille établie à Martel, où il a conservé sa maison, depuis plusieurs générations.

Evoquer un siècle d’enseignement à Martel (1850-1950), c’est tout à la fois marquer le passage d’une instruction souvent réservée à la partie la plus favorisée de la population, à un enseignement public dispensé plus également.
C’est aussi évoquer le passage, parfois moins conflictuel qu’on ne le croit, d’une école congréganiste à un enseignement laïque dont on ne peut nier les effets bénéfiques.
C’est enfin, pour nombre d’entre-nous, retrouver les souvenirs de nos jeunes années ou ceux de nos parents.
Le colloque organisé en 2005 avait pour objet d’évoquer la situation du « Pays Martelais » et les difficultés de communes sans grands moyens financiers, écartelées entre les convictions de leurs habitants, mais attentives aux progrès à accomplir pour favoriser le développement des jeunes générations. Il offrait aussi l’occasion de dresser le portrait de quelques enseignants passionnés par la mission dont ils se sentaient investis.
Au moment où l’on s’interroge sur le fonctionnement de « l’ascenseur social » c’était enfin l’occasion d’analyser les mécanismes de la promotion sociale mis en œuvre à cette époque et le rôle des différents acteurs : pouvoirs publics, enseignants, adolescents. Pourquoi ne pas essayer, aujourd’hui, d’en tirer quelques leçons ?
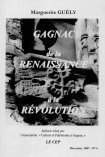
Cette brochure du CEP est constituée par la matière de trois causeries présentées à Gagnac par Marguerite Guély en octobre 2002 (Gagnac aux temps modernes), octobre 2003 (Gagnac au XVIème siècle) et octobre 2006 (Familles nobles et notables de Gagnac sous l’Ancien Régime), transcrites et mises en forme sous le contrôle et avec son accord par Robert Larue. Leur juxtaposition engendre quelques redites, dont le lecteur acceptera sûrement volontiers de nous excuser.
Nous y avons adjoint des annexes qui éclairent l’un ou l’autre des sujets abordés dans le texte principal. Ce sont des documents issus pour certains d’archives personnelles que des particuliers ont bien voulu mettre à la disposition du CEP, pour d’autres, de recherches effectuées aux Archives Départementales. Les éléments de généalogie concernant les familles de Lagrènerie et de Lavaur sont le fruit d’un travail considérable – dont ils ne sont qu’une toute petite partie – effectué par Guy Dauphin à partir des registres paroissiaux d’état civil sur les familles de Gagnac aux XVII et XVIIIème siècles.

