Étonnante destinée que celle de Raymond Lacombe.
C ‘est à la sortie de la guerre que ce paysan de l ‘Aveyron se révèle. De la petite école de Camboulazet, où il est né en 1929 et décéé en 2002, à la présidence de la Fnsea l ‘homme a affermi ses convictions sociales et chrétiennes. Nourri de Saint Augustin, Teillard de Chardin ou Thomas d ‘Aquin, « Raymond » est devenu le « Premier paysan de France » sans jamais renier ses origines rurales. En 1953, dans sa lettre intitullée « Mettre l ‘homme au centre du débat « , il lance son combat dans la Jeunesse Agricole Chrétienne. IL ne cessera jamais de militer. Celui que l ‘on pourrait qualifier de conservateur n ‘a pourtant jamais cessé de s ‘adapter, de réfléchir, méditer. Durant un demi-siècle son combat sera celui des valeurs du monde rural. Au fil de l ‘ouvrage se dessine un homme délicat dans la reflexion, déterminé dans l ‘action. En 1961, il n ‘hésitera pas à passer son réveillon de Noël dans les mines de Décazeville pour concrétiser la solidarité entre paysans et ouvriers. Il assiste à l ‘irrésistible chute du monde agricole ne cessant jamais de faire gronder sa voix chaleureuse et ciselée dans ses lectures. Au-delà de l ‘hommage le livre rapelle les grands moments de lutte des agriculteurs pour leurs terroirs.
Catégories Librairie : Histoire - Documents Page 16 of 20
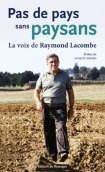

La guerre de Cent Ans ! Aujourd’hui presque oubliée, elle entraîna pourtant vers la mort des dizaines de milliers d’individus dans tout le royaume de France.
En Quercy, ses effets furent effroyables car la province était une zone “frontière”, aux portes de l’Aquitaine anglaise. Lorsque les premiers détachements anglais se ruèrent vers la ville en 1345, les consuls de Cahors prirent immédiatement toute une série de mesures pour renforcer les défenses.
Tout au long du conflit, ils poursuivirent leur action, organisant leurs forces, achetant de l’artillerie, construisant des fortifications.
Les Cadurciens d’alors consentirent d’importants sacrifices financiers pour se protéger, mais c’est physiquement qu’ils payèrent le plus de leurs personnes.
Réquisitionnés pour construire les murailles, ils montaient la garde jour et nuit et combattaient les armes à la main. La guerre n’était pas le seul fléau du temps : les désordres climatiques occasionnèrent la perte des récoltes et des famines à répétition, tandis que les épidémies de peste se succédèrent à partir de 1348.
Vers 1440, c’est appauvrie,
différente et diminuée de moitié que la société cadurcienne retrouva la paix.
C’est cette période noire, qui fut si longue, que le présent ouvrage vous invite à découvrir.

« René Yronde raconte sa vie, son temps sans cesse qui le ramène au bord de la dordogne, qui nulle part n ‘est plus belle qu ‘à Souillac. Mayrac et la maison familiale, Pinsac et les « flons-flons » de la fête., Souillac où il vécut ses deux passions, son métier d ‘instituteur et sa vocation de correspondant de presse. Nous avons tous regretté, un jour ou l ‘autre, de ne pas avoir su conserver ces souvenirs d ‘un temps passé qu ‘ont toujours égrenés celles et ceux qui nous ont quitté… » »
Cet extrait de la préface signé de Martin Malvy, actuel président du Conseil général de Midi-Pyrénées, résume bien l ‘esprit de cet ouvrage, qui constitue un témoignage que les moins de vingt ans ne peuvent pas connaître.

Cet ouvrage est né d’une passion ! La passion de toute une équipe pour son histoire… Remonter « dans le temps » n’est pas seulement la recherche d’anecdotes, de noms et d’ancêtres décrépis. C’est un puzzle. S’il manque un morceau, rien ne peut-être construit § Le moindre détail a son importance. Il faut chercher, fouiner, ne jamais se décourager.
Nous avons eu la chance de pouvoir étudier une grande partie des actes des notaires Escudié. Papiers déjà chiffonnés, relégués au fond d’un grenier, puis jetés aux ordures, ils auraient fini « papiers pourris » si des mains compatissantes ne les avaient sauvés.
Frottés, dépoussiérés, photocopiés, déchiffrés, lus et relus avec passion et mal de tête, nous les avons transcrits en phrases claires, faciles à lire et contenant « l’essentiel ». Le détail est dans la photocopie du document original. Nous présentons au lecteur ces 3014 actes en espérant qu’il y trouvera du plaisir, de l’étonnement ainsi que le désir de découvrir et protéger ce passé si passionnant….
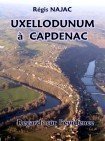
En l’an 51 avant notre ère, 30 000 légionnaires romains font le siège d’un oppidum aux portes du pays cadourque et dans lequel 2000 irréductibles Gaulois résistent encore et toujours à l’envahisseur.
La polémique entourant l’emplacement d’UXELLODUNUM, ce dernier village celtique ayant plié sous le joug de César, loin de s’être éteinte avec la localisation officielle au Puy d’Issolud en 2001, relance un débat ne portant plus sur une erreur mais bien sur une mystification. Cette bourde on la doit à Napoléon III, qui contre l’avis de Jean François CHAMPOLLION, (dit CHAMPOLLION FIGEAC), décide en 1865 de cette invraisemblable reconnaissance d’un lieu où rien ne concorde avec les textes antiques. Dans son ouvrage « UXELLODUNUM à CAPDENAC», Régis NAJAC nous livre ces « Regards sur l’évidence », négligés par ceux qui imposent l’histoire en remplaçant un faisceau de preuves par leur faisceau de convictions.
Ce livre comporte 19 chapitres et sous chapitres, dans lesquels sont exposés clairement les éléments essentiels à la compréhension du sujet dont le public ne connaît souvent que des bribes et quasi exclusivement celles confortant la thèse officielle :
Présentation de l’Association pour Uxellodunum à Capdenac, et de l’archéologue Roger Marty.
Présentation des travaux anciens et récents, (de Napoléon III et Jean François Champollion, jusqu’à ceux de l’Association Pour Uxellodunum à Capdenac, (APUC), et s’appuyant sur les documents, notes et manuscrits de L.Corn, A. Sors, J. Ventach, R. Marty, etc.)
Traduction intégrale du texte latin d’Hirtius
Exposé sur les invraisemblances de la localisation officielle
Présentation de la thèse Capdenac, mentions historiques concernant Uxellodunum à Capdenac (17 dates depuis 1214, 1320 etc.), nombreuses vues aériennes, dessins, plans et croquis annotés et en couleurs du site de Capdenac Rapport sur le système hydrologique du siège encore en place et pratiquement intact, (photos de tous les éléments, relevés, plans, etc),
Chapitre inédit sur la Fontaine romaine dite des « Anglès », avec photos et relevés
Présentation commentaires et vue de la maquette du site, inédite et irréalisable sur quelque autre site
Documents et objets provenant du site (collections privées, et de l’APUC), documents etc.
Cette brillante démonstration de 100 pages format A4, rigoureusement documentée et riche de très nombreuses photographies et documents en couleurs, est préfacée par Danielle PORTE, maître de conférences à la Sorbonne et spécialiste de l’histoire et des religions romaines qu’elle enseigne au sein de l’Institut d’études latines. (articles de presse, La Dépèche du Midi, Le Villefranchois, La Vie Quercynoise, Radios, CFM….
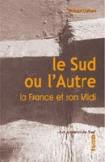
La France s’est faite d’un Nord (“la vraie France”, selon Michelet) et d’un Midi, qui pour l’essentiel est le pays d’une autre langue, la langue d’oc, d’une autre culture et d’un autre “tempérament”. Mais officiellement la création originale représentée par cette littérature occitane de niveau européen, est étouffée et maintenue au “secret d’État”.L’auteur entend ici aller plus loin qu’une dénonciation de cette mise aux oubliettes. Il veut montrer quelles distorsions ce préjugé entretient au coeur même du sentiment national et comment l’absence d’une reconnaissance de l’Autre, du Midi, crée un malaise de la conscience collective, qui résonne dans des oeuvres de la littérature de France.Il choisit pour cela trois grands moments de la genèse du fait national.- Au XIIe siècle, entre 1100 et 1150, le pays d’oc prend une avance littéraire fulgurante. Dans le domaine de la création narrative et épique, il en serait de même si une vague d’oïl ne submergeait pas la création méridionale à partir du XIIIe siècle. Ainsi se met en place un couple idéologique: le Midi est lyrique, raffiné et féminin, le Nord est héroïque, brutal et mâle, et l’enseignement éduquera les Français au Nord seul, responsable de l’”épopée nationale”.- Au XVIe siècle, au sortir des guerres de Religion, une littérature d’oc se reconstitue autour principalement d’Henri III de Navarre, le “héros gascon”. Le Nord se réserve l’“être” et enferme le Midi dans le “paraître”. – Au XIXe siècle, la France s’industrialise et crée autour de Paris, une classe bourgeoise qui porte la nation moderne. Pour celle-ci, le Midi devient un pays lointain. Parallèlement, la vague européenne des nationalités éveille une nouvelle littérature d’oc qui atteint un sommet avec Mistral. Trois auteurs provençaux servent à appronfondir l’analyse du “mal d’être” méridional jusqu’à un mal intime du sujet écrivant: Daudet, Giono et Pagnol.

Cet essai présente simplement un » armorial » à ceux qui aiment l ‘étude du passé. Il puise à toutes les sources disponibles concernant tant le Quercy que les provinces voisines, et donne une grande importance aux seules armoiries. Pour rompre la sécheresse d ‘un pur armorial, il indique chaque fois que cela est possible, les seigneuries possédées par les familles citées.
Réimpression de l ‘édition de Paris-Cahors, 1907-1908. Planches.

Table des matières
Avant propos
Inventaire des archives du château de Reyniès
Famille de la Tour de Reyniès
Famille de Seguin de Reyniès
Bien et droits : Reyniès – Moulis – La Mothe Saillens – Corbarieu – Nohic, Orgueil, Montauban – Villemur – Saint-Nauphary
Biens et droits en Gévaudan
Famille de Laporte de Larnagol
Biens et droits en Quercy : Larnagol, Les Vignes
Famille de Gondrecourt
Famille de Villers
Leclerc de Fourolles
Bonneville
Deschamps
Collet de Vermanton
Cuisinier
Index alphabétique
Annexes
Généalogies : de La tour, Seguin de Reyniès, Laporte de Larnagol, Lantron de Saint-Hubert, Gondrecourt, Courtois de la Motte, Sauzin, de Villers, Boudin de Roville
Lettres d ‘Étienne Seguin de Marvejols

Cet ouvrage regroupe les actes d’un colloque qui s’est tenu les 21 et 22 août 2003 à Martel sur la thématique de la vie quotidienne à Martel au XIXe siècle. Au cours de ces journées, les thèmes traités sont aussi divers que la vie politique et administrative, l’état social et économique, l’aménagement urbain, les maisons de la ville… Dans un proche avenir, l’association se propose d’organiser une série de rencontres (conférences, tables rondes…) ; un colloque est d’ores et déjà envisagé en 2005 sur le thème de « L’enseignement à Martel de 1850 à 1900 ».
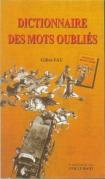
Ils sont malheurement pléthore ces mots qui nous quittent sur la pointe de leur tracé, faute d’être utilisés. Oubliés, « seuls quelques écrivains vigilants, quelques locuteurs gourmets perpétuent leur souvenir ». Pourtant ils sont beaux à l’oreille ces mots – « Architriclin », « vultueux », « zinzolin »… – qui manquent à jamais à notre vocabulaire. Ce « Dictionnaire des mots oubliés » vous propose une balade sur les terres d’Antoine Furetière, d’Émile Littré, de Pierre Larousse. La moisson est d’autant plus fabuleuse que la cueillette de l’auteur confine à la passion. Après le chapitre consacré à l’histoire des dictionnaires des XVIe et XIXe siècles, partez avec voyelles et consonnes pour un voyage lexical dépaysant. Peut-être adopterez-vous quelques-uns uns des 1459 mots présentés, pour le plus grand bien de notre expression quotidienne.
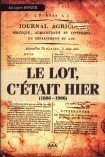
Prenant le Lot comme département témoin, l ‘auteur restitue, par l ‘intermédiaire d ‘articles parus dans la presse quercynoise, la vie, les usages et les moeurs d ‘autrefois. Depuis le premier journal, daté du 3 août 1806, conservé aux Archives, jusqu ‘aux diverses publications du début du XXe siècle, cent ans d ‘Histoire et de petites histoires qui provoquent la curiosité, l ‘amusement ou la stupéfaction des lecteurs locaux ou d ‘ailleurs.
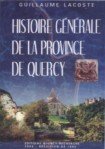
Véritable monument de l ‘édition régionale, cette bible de l ‘histoire locale a été publiée une première fois en 1883.
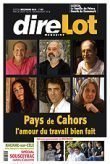
Depuis 1965, Michel Lorblanchet, directeur de recherches au CNRS s’affirme comme l’un des spécialistes des grottes ornées. Vers 1860-1870, Victor Brun explore les remplissages de diverses cavités de la vallée de l’Aveyron, puis aux environs de 1880-1890, Félix Bergougnoux effectue les mêmes recherches dans les vallées du Lot et du Célé. Ils publient des éléments de bois de renne sculptés ou portant des gravures. En 1919, l’abbé Lemozi découvre les premières gravures pariétales de la région sur les parois de l’abri Murat (Lot). C’est également dans les niveaux archéologiques du même gisement, qu’il révèle par ses fouilles la richesse de l’art mobilier de l’Age du Renne dans le Haut-Quercy. En 1920, il découvre encore les premières grottes ornées de la vallée du Célé : Marcenac, Cantal, Sainte-Eualie. Il entraîne les jeunes de sa paroisse à l’exploration des cavernes, et ainsi en 1922, deux adolescents, André David et Henri Dutertre, pénètrent les premiers dans les galeries peintes du Pech-Merle…
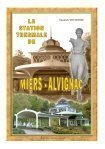
L ‘eau minérale de la source Salmière, connue et appréciée de longue date – son utilisation remonterait à l ‘époque romaine – a fait l ‘objet en 1624 d ‘une première communication de Fabry, médecin du roi Louis XIII. Depuis, le corps médical lui a reconnu diverses propriétés thérapeutiques.
Après un séjour de près de 10 000 ans dans les roches du Quercy qui lui confère sa minéralisation exceptionnelle, l ‘eau de la source Salmière jaillit naturellement à la station thermale de MIERS-ALVIGNAC, qui recevait les malades pour des cures de boisson, jusqu ‘à sa fermeture en 1979.
Endormi dans un cadre romantique, tout près d ‘un lac, au fond de la combe de Molière, le bâtiment de la galerie-buvette de MIERS-ALVIGNAC, oeuvre d ‘une architecture originale que l ‘on doit à l ‘ingénieur François HENNEBIQUE qui le conçut et le réalisa en 1910, constitue aujourd ‘hui une véritable curiosité pour les touristes.
L ‘auteur nous en propose la visite au travers d ‘un ouvrage attrayant et documenté qui traite des propriétés de l ‘eau minérale de la source Salmière, de l ‘hydrogéologie locale et de l ‘histoire de la station thermale.
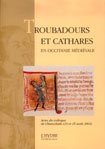
Troubadours et cathares… un couple qui a fait couler beaucoup d ‘encre et suscité bien des théories, certaines tout à fait fantaisistes. Mais au fond, la vraie question demeure celle-ci
parce que ces deux phénomènes historiques furent contemporains, furent-ils forcément liés d ‘un point de vue doctrinal ? Les Actes de ce colloque de Chancelade ont le mérite d ‘avoir réuni autour de ce problème les plus grands spécialistes du catharisme, des troubadours, enfin de la langue et de la société occitane médiévale… Tous abordent le sujet avec le sérieux qu ‘on leur connaît et le lecteur trouvera ici bon nombre de réponses aux nombreuses questions que soulève la coexistence historique du catharisme et de la culture des troubadours.

