Réédition Quercy Recherche, Cahors (46), Format 16×24 cm, 120 pages, 1994.
Eugène SOL


Edition originale de 1899, réédition Quercy Recherche, Cahors (46), Format 14,5 x 21 cm, 104 pages, 1998.
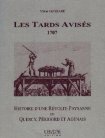
Les provinces du Sud-Ouest, durant le XVI eme et XVII eme siècle, furent terrain de prédilection des révoltes populaires.
En Mars 1707, dans la tradition de leurs anciens, sur les plateaux du Quercy, du Périgord et de l ‘Agenais, une flambée de colère souleva les paysans contre une oppression fiscale.
Ces Tards Avisés sortirent de leurs champs, par communautés entières, pour aller défier de leurs armes hétéroclites les villes proches. ILs assiégèrent en vain Cahors, menacèrent Sarlat et Gourdon, saccagèrent des maisons et des métairies aux alentours de Tournon.
Réduits à eux mêmes et en butte à une répression militaire, ils se dispersèrent au mois de mai. Mais l ‘impôt provocateur fut suspendu.
Leur histoire, ici racontée, est fragment d ‘Histoire et contrepartie de l ‘oubli.
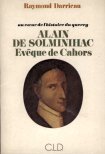
Au coeur de l ‘histoire du Quercy,
ALAIN DE SOLMINHIAC, Evêque de Cahors (1593-1659). La sainteté d ‘un pasteur d ‘âmes, au lendemain du Concile de Trante.

Du vieux Collège Saint-Michel et de l ‘Université, créée par le Pape Jean XII en 1331, jusqu’au Collège Gambetta d ‘aujourd’hui, que de péripéties dans l ‘histoire mouvementée, passionnée et passionnante, de cet établissement cadurcien, qui fût tour à tour « Institution de la Jeunesse et du Quercy « , Collège des Jésuites, Collège Royal, École Centrale du Département, Lycée Impérial, à nouveau Collège Royal puis Lycée, avant de devenir Collège d ‘Enseignement secondaire en 1974 !

Auteur de plusieurs articles dans notre bulletin, conférencier de notre séance d’hiver de décembre 2001 (“L’imprimerie cadurcienne, miroir de la Contre-Réforme”), Patrick Ferté, maître de conférences d’histoire moderne à l’Université de Toulouse-Le Mirail, nous livre aujourd’hui le premier volume d’un travail monumental consacré aux étudiants méridionaux de 1561 à la Révolution.
Spécialiste très reconnu de l’histoire des anciennes universités et notamment par sa thèse sur l’université de Cahors au XVIIIème siècle, il a entrepris de répertorier tous les étudiants des diocèses du Midi de la France. Répertoire nominatif et non anonyme, avec les origines et le cursus de chacun. L’outil informatique lui a permis “de passer au crible plus d’un million d’actes universitaires” que le hasard des archives a heureusement conservé, à l’inverse du Nord de la France.
Dans une riche introduction Patrick Ferté présente sa méthode, déjoue les pièges et justifie son parti. Le comptage par diocèse, et non par université, permet seul aux historiens de tirer le meilleur profit de ces sources inestimables, c’est-à-dire de définir les liens entre l’institution universitaire et les mouvements démographiques, avec ceux conjoncturels, de l’économie, mais aussi avec les stratégies culturelles des élites… et des autres.
L’historien de la société puisera dans ce répertoire pour montrer combien les universités d’Ancien Régime ont favorisé la reproduction des gens en place, “officiers” propriétaires de leur charge mais contraints d’obtenir un parchemin (plus ou moins régulièrement parfois). Elles ont permis aussi une réelle ascension sociale prouvée par la fréquentation universitaire de fils de la moyenne bourgeoisie, marchands, ou maîtres-artisans. On pouvait également aller à l’Université, à titre purement décoratif, sans songer à en utiliser l’enseignement !
Préfacé par Dominique Julia, spécialiste éminent de l’histoire de l’éducation, ce premier volume concerne les diocèses d’Albi, Castres, Lavaur, Montauban, c’est-à-dire partie du Quercy pour ce dernier. On y voit l’aire de recrutement de notre Université cadurcienne jusqu’en 1751, date de sa suppression. Le second volume, à paraître, couvrira le diocèse de Cahors : six seront nécessaires pour répertorier les 40 000 étudiants concernés.
Tout un pan de l’histoire sociale de notre Midi sera alors disponible qui pourra nourrir bien des secteurs de la recherche : socioculturelle, religieuse, intellectuelle. Les généalogistes bénéficieront, et déjà grâce à ce premier volume, d’un exceptionnel gisement pour leurs enquêtes.
Etienne Baux.
Patrick Ferté est maître de conférences d ‘histoire moderne à l ‘Université de Toulouse-Le Mirail. Spécialiste de l ‘histoire des anciennes universités méridionales, il est l ‘auteur de plusieurs ouvrages sur ce thème et de maints articles scientifiques publiés en France et à l ‘étranger (Irlande, Espagne, Mexique, Canada…).
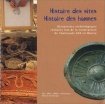
Aujourd ‘hui, plus aucune autoroute n ‘est créée en France sans que sa construction ne soit précédée d ‘opérations d ‘archéologie préventive destinées à sauvegarder les éléments les plus importants de notre patrimoine culturel. L ‘autoroute A20, l ‘Occitane en Quercy, qui relie Montauban à Brive n ‘a pas échappé à cette règle.
Jusqu ‘en 2001, pendant plus de 5 ans, les archéologues ont travaillé à rechercher, reconnaître et étudier les sites susceptibles d ‘être menacés par les travaux autoroutiers. Leurs efforts, et ceux d ‘Autoroutes du Sud de la France qui a financé les opérations, ont été largement payés de retour : des plus anciens peuplements de la région, il y a plus de 300 000 ans, jusqu ‘à l ‘aube des temps modernes, la moisson de données sur l ‘histoire de l ‘homme en Quercy est impressionnante. Les informations collectées sur près d ‘une cinquantaine de sites, au long des 130 km du tracé de l ‘autoroute, dépassent bien souvent par leur intérêt et leur nouveauté le cadre local et régional. Elles contribuent à placer le Quercy au cœur des problématiques des recherches les plus actuelles dans de nombreux domaines : modes de vie, pratiques funéraires, agriculture et commerce, influences culturelles…
Au travers du présent ouvrage, c ‘est l ‘aventure de ces recherches, celle de l ‘homme en Quercy et toute la richesse et la diversité de son patrimoine archéologique que les archéologues, en allant au-delà de la simple restitution des données auprès de la communauté scientifique, ont ici fait le choix de donner à voir au public le plus large.

Présentation :
Qui se souvient qu ‘en 1790, lorsque l ‘Assemblée Constituante mit en place les départements français, le Tarn-et-Garonne n ‘existait pas. Montauban, malgré les titres de son passé, n ‘était qu ‘une simple sous-préfecture lotoise.
C ‘est Napoléon, en voyage dans le Sud-Ouest, qui rattrapa cette injustice: posant sa main à plat sur une carte, il dessina à gros traits le département du Tarn-et-Garonne: un peu de Rouergue et de Quercy, quelques coteaux de Lomagne autour des plaines alluviales. Telle est l ‘histoire de la naissance de cette étonnante mosaïque où des gens vivent, travaillent, et sont parfois heureux, comme nous le montre cet ouvrage.
L ‘auteur, Régis Granier, y a juxtaposé, pour le plus grand plaisir du lecteur, des images du début du siècle et des anecdotes de la vie quotidienne. Ainsi renaissent les silhouettes d ‘antan des hommes, femmes ou enfants, nés ici ou venus d ‘ailleurs, qui animèrent les rues et les places, les champs et les villages du département.
Avec La vie d ‘autrefois en Tarn-et-Garonne, Régis Granier nous offre un livre tonique, passionnant, savoureux, riche d ‘évocations du passé. Un livre à lire aussi bien qu ‘à feuilleter, un document!
Présentation de l ‘auteur :
Régis GRANIER, a publié de nombreux livres, dont « Le Gers autrefois » et « Le Tarn-et-Garonne autrefois « , tous deux aux Editions Horvath.
Sommaire:
– Trois pas dans le passé
– Quelques paysages
– Fleuves et rivières
– Les gens d ‘ici
– Le progrès en marche
– Les hommes et leurs travaux
– Quelques faits divers
– La guerre marque la fin de la Belle Epoque
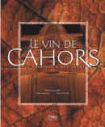
De l ’empire romain au machinisme du XXe siècle, … voici enfin l ‘histoire illustrée d ‘un vignoble deux fois millénaire. Riche d ‘enseignement et d ‘images capiteuses, ce beau livre dresse le paysage contrasté d ‘un vin en pleine évolution, désormais servi sur les meilleures tables. Le nom de Cahors sonne maintenant bien haut dans la bouche des fins connaisseurs.
A feuilleter sans modération.
Fièrement propulsé par WordPress & Thème par Anders Norén