Gustave était jardinier. Sa maison, son jardin et la grange où il enfermait son âne existent encore, près du ruisseau. Même aujourd’hui, alors qu’il nous a quitté depuis de trop nombreuses années, il n’y a personne au village qui ne sache cela.
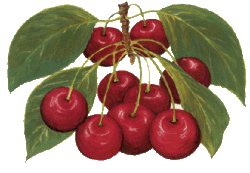 Plus rares sont ceux qui se souviennent de ses cerises.
Plus rares sont ceux qui se souviennent de ses cerises.
Lorsque je l’ai connu, Gustave était en age d’être Grand-Père. Sa moustache grisonnante et son magnifique sourire lui auraient permis d’être un papy très apprécié si Albertine, sa femme, lui avait donné une descendance mais, et là était son drame, Albertine et la médecine de l’époque n’avaient rien pu faire pour cela.
Condamné à voir grandir hors de chez lui les enfants du village alors qu’il aurait voulu en remplir sa maison, il reportait sur les écoliers dont j’étais un peu de la tendresse malicieuse qu’il n’avait pu extérioriser.
Nous étions quatre du causse qui, sur le chemin de l’école, passions devant sa vigne deux fois par jour. Celle-ci, accrochée au flanc du coteau, à mi-parcours entre la maison et le bourg où sévissait l’institutrice, nous fournissait l’occasion d’une halte lorsque nous remontions le soir vers le mas Delleu où nous attendaient les devoirs et le troupeau à garder.
Pour ces deux raisons, il arrivait que la halte se prolonge. En mai s’ajoutait une troisième raison. En bordure de la vigne, les deux immenses cerisiers qui surplombaient la route étaient couverts de fruits. Que celui qui n’a jamais commis ce genre de larcin nous jette le premier noyau ?
Gustave s’étant rendu compte que les branches les plus basses ne portaient pas de fruits cette année-là, se cacha dans la cabane qui existe encore pour identifier les moineaux qui se gorgeaient de ses cerises. Il nous menaça plusieurs fois mais chaque soir la tentation l’emportait sur la crainte, toute relative d’ailleurs, qu’il nous inspirait.
Un jour, à court d’argument alors qu’il nous avait pris sur le fait une fois de plus, il vint vers nous avec le sourire et un calme qui nous fit oublier de détaler comme nous en avions l’habitude. « Mangez-en bien les petits » nous dit-il « car je les pique avec un produit qui donne mal au ventre ». Penauds et inquiets, nous nous regardâmes avec inquiétude avant de reprendre notre route.
Le lendemain, nous n’étions que trois sur le chemin du retour. Le quatrième, affaibli par une magistrale diarrhée qui l’avait tenu éveillé toute la nuit, avait gardé la chambre. Ce soir-là, à la hauteur de la vigne nous fîmes un détour pour éviter les cerisiers. Gustave qui nous guettait en fut surpris et, je le crois, aujourd’hui, un peu déçu.
Quelques jours plus tard, à l’heure de la fin des cours, un orage menaçait. Toute l’après-midi les nuages noirs avaient tourné au dessus des tours du château comme de gros oiseaux qui cherchent à se poser.
Dans notre insouciance et bien que nous ayons suivi les hirondelles à travers les fenêtres de la salle de classe, nous n’avions pas compris ce qu’elles annonçaient pas leur vol bas.
Pressentant l’orage, Gustave nous rencontra alors qu’il rentrait précipitamment chez lui et que nous attaquions la montée. Il comprit qu’il devait nous obliger à nous abriter et le brave homme ne trouva rien de mieux que nous inviter à « faire quatre heures ».
De nos jours les enfants font peu d’exercice : ils « goûtent » au retour de l’école. La publicité télévisée leur vend pour cela des friandises survitaminées et emballées dans de jolis papiers, qui conviennent à leur petit appétit.
J’emploie l’expression « faire quatre heures » afin qu’il n’y ait pas de confusion à ce sujet. Outre les deux kilomètres matin et soir, nous participions aux travaux de nos parents. Nous ne pûmes résister longtemps à la perspective de tailler dans la miche une large tranche de pain que l’on accompagnerait de jambon ou de pâté et que l’on finirait à la confiture.
C’est ainsi que nous vîmes passer l’orage, au sec. Il y eut le jambon, le pâté et la confiture servis par Albertine, mais nos estomacs bien pleins se serrèrent lorsque nous vîmes arriver … un panier de cerises. Nous refusâmes tous en chœur et poliment comme nos parents nous l’avaient appris.
Albertine ne comprenait pas et semblait fâchée. Gustave n’en revenait pas mais rigolait doucement. Il dût, pour nous convaincre de les goûter du bout des lèvres, nous expliquer avec beaucoup de détails, qu’il ne piquait qu’une partie de ses fruits et qu’il avait un secret pour reconnaître ceux qu’il avait traités des autres.
Nous étions à l’âge des secrets et nous parlâmes longtemps de celui-là sans jamais arriver à le percer.
Gustave n’est plus parmi nous. Si sa cabane existe encore, sa vigne a été arrachée et sans travail les cerisiers sont morts. Je sais que le produit avec lequel il voulait défendre ses cerises n’existait que dans son imagination et que c’est l’abus ces dernières qui provoque le mal de ventre.
Seulement m’est resté de ce printemps, avec cette histoire, la tentation des gros fruits rouges qui m’habite encore lorsque je refais ce chemin.
Bernard DAVIDOU 1998


Laisser un commentaire