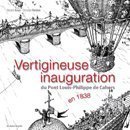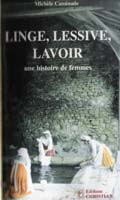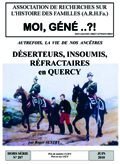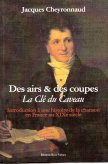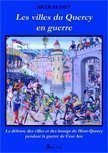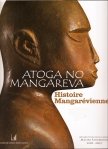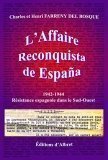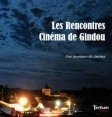Le 6 mai 1838, le pont Louis-Philippe lancé sur la rivière Lot fut inauguré et livré à la circulation le jour de la fête du Roi. Construit en quatre ans, il remplaçait le pont médiéval en ruines situé quelques mètres en amont. Ce splendide ouvrage, le plus utile que l’on ait bâti à Cahors depuis des siècles, fut l’occasion d’une cérémonie grandiose devant des milliers de spectateurs massés sur les quais et les pentes voisines. La dernière pierre de la cinquième voûte y fut scellée accompagnée d’un coffret rempli d’objets symboliques (pièces d’or et d’argent à l’effigie du Roi,…).
Les discours officiels, le cérémonial, les réjouissances qui suivirent permettent de découvrir le Cahors du temps, bourgeois et distingué, mais aussi populaire et bon enfant, à travers le récit qu’en fait Etienne Baux, servi par les dessins précis et très documentés de Christian Verdun qui, tel un journaliste reporter, a couvert l’événement, quelques 172 ans plus tard…
Ce livre clôt la trilogie que Christian Verdun a consacré aux ponts de Cahors : « La cité vertigineuse » en 1989, édité chez Flac!, puis « Les vertiges de la cité » chez L’Hydre édition en 2007.
LES AUTEURS
Christian Verdun est né à Paris en 1941. Depuis, ou presque, il n’a jamais cessé de dessiner, enfant, puis étudiant à l’Université de paris où il obtient le Diplôme Supérieur de Dessin et d’Arts Plastiques. Fixé dans le Lot depuis plusieurs décennies, il connaît bien Cahors où il a terminé sa carrière d’enseignant…
Etienne Baux est professeur agrégé d ‘histoire au lycée Clément Marot de Cahors, chargé de cours à l ‘université de Toulouse le Mirail. Il est membre de la Société des Etudes du Lot et participe à de nombreuses conférences sur l’histoire de son département.