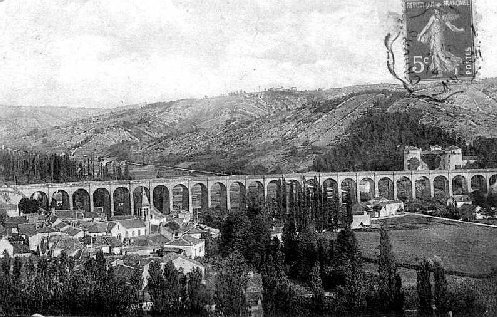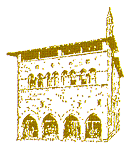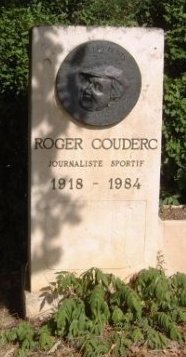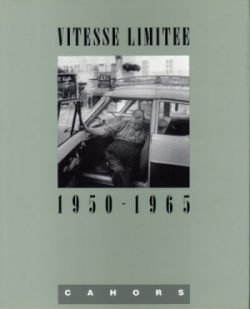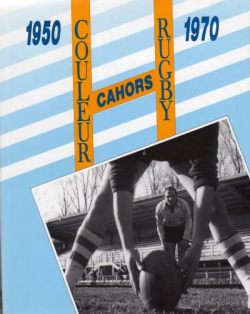Le martien de la combe de la croix
par Bernard Davidou
Parfois, les soirs d’été après le repas, je prends ma canne et je me laisse porter par mes pas. Tout en remuant les pensées de la semaine, je rends visite à mes amis les chênes, j’écoute le vent et essaye de surprendre les biches ou sangliers qui sont très nombreux dans nos bois.
 Je devine sous le tapis végétal, les traces de nos prédécesseurs, murettes, gariottes ou chemins abandonnés, pampres attestant la présence d’une ancienne vigne et j’imagine les hommes qui depuis les soldats sur la voie romaine à nos jours se sont succédés sur cette terre ingrate où je suis né et je retournerai.
Je devine sous le tapis végétal, les traces de nos prédécesseurs, murettes, gariottes ou chemins abandonnés, pampres attestant la présence d’une ancienne vigne et j’imagine les hommes qui depuis les soldats sur la voie romaine à nos jours se sont succédés sur cette terre ingrate où je suis né et je retournerai.
Un jour mes pas me conduisirent dans la combe de la croix (sur la commune de Calamane) où je m’assis sur une souche pour profiter des dernières couleurs du ciel. Devant moi s’étendait une petite clairière.
Tout était calme et le jour finissait doucement, me permettant de retrouver l’équilibre après une semaine dans la fébrilité de Toulouse. Dans le cours de ma rêverie je me remémorais les propos de mon ami Daniel à qui j’avais fait lire quelques jours auparavant une de ces petites histoires où, sur une page maximum, je raconte un souvenir ou invente une histoire autour de celui-ci.
« C’est bien toi ! Tu es toujours tourné vers le passé de ton village natal. » Je n’ai jamais eu d’autre ambition ce faisant, que de m’évader d’un « comité stratégique de direction » ou d’une réunion de type « brain storming » décidée par le président sur le conseil cher payé d’un consultant, (comme Daniel), extérieur à l’entreprise qui avait la faveur très éphémère du précédent.
Cependant, Daniel avait raison et comme je regrettais de ne pas être né plus tard, au cœur d’une ville tentaculaire, dans un appartement aseptisé et ripoliné et une famille sans passé, ne faisant aucun cas de ces absurdités. La vie eut été plus simple, je n’aurais eu que l’avenir à assumer.
J’en étais là de mes pensées lorsque je pris conscience de sa présence attentive mais discrète. Il m’observait sans bouger depuis quelque temps certainement, car les grillons et les oiseaux dont j’avais inconsciemment noté le silence subit peu de temps auparavant avaient repris leurs chants.
C’était un petit homme vert de la tête aux pieds, affublé d’une antenne sur le casque et d’un giro-phare que – me dit-il plus tard – les règles de la politesse martienne obligent à éteindre quand on veut engager la conversation.
Nous nous saluâmes fort civilement et je l’invitai à prendre place à côté de moi sur mon tronc d’agar. Après quelques banalités sur le temps sur terre, la dernière histoire de Bouvard aux grosses têtes, il me demanda de reprendre le cours de mes réflexions qu’il avait suivi car il accédait sans peine à la longueur d’onde de celles-ci, comme celles de tous les autres humains: Il avait été programmé pour cela avant son départ de sa base cosmique, (baptisée «Aldous Huxley » en hommage à notre écrivain visionnaire,) dont il me montra la direction dans le ciel.
Peu soucieux de trouver un allié à Daniel et un second détracteur de mes rêveries, je refusai de les poursuivre et lui demandai de me parler de lui et de ses souvenirs de jeunesse.
Il se figea dans un garde-à-vous impeccable et éructa une bordée de x d’y de z et de t suivie d’un numéro qui correspond à son nom mais contient aussi toute l’information utile pour le joindre et le réparer quand c’est nécessaire. Il me parla un peu de sa naissance qui résultait d’une manipulation de cellules « in vitro » dans le laboratoire central (1), mais fût incapable de m’en dire plus sur ce qu’avait été son enfance ou l’histoire de sa famille.
Il semblait gêné d’aborder ce sujet, comme s’il était obscène ou injurieux d’évoquer tout ce qui a trait à la mémoire. Pressé par mes questions, je compris par ses réponses que le mot « mémoire » n’avait pas, chez lui, le sens que nous lui donnons. Il s’agissait pour lui d’un terme technique qui désignait l’information que le laboratoire central installait dans chaque individu. Celle-ci était limitée au strict nécessaire pour le bon fonctionnement de la machine ultra-sophistiquée qu’il était.
Je n’insistai pas sur ce sujet. Après un moment de silence qui nous permit d’apprécier la féerie du crépuscule qui s’installait, il en vint à ce qui était son objectif en venant vers moi. Peu de temps auparavant, sur ordre du grand ordonnateur d’Huxley, il avait récupéré deux de nos compatriotes « le bombé » et «le glaude », afin de produire sur sa planète la fameuse soupe aux choux décrite par René Fallet.
Sa seconde mission, aujourd’hui, consistait à trouver la boisson qui serait digne d’accompagner ce plat qui, depuis lors, faisait fureur sur mars. Sans hésiter et avec le prosélytisme que j’ai toujours manifesté pour notre noble breuvage, je lui suggérai le vin de Cahors. Je lui conseillai aussi, pour les soifs d’entre les repas, un fond de verre de cet excellent « ratafia » que fabrique mon Beau-Frère, René.
Malgré le nombre respectable de méga-hertz de son unité centrale il eut du mal à prononcer correctement ce mot et s’amusait à le répéter comme un parisien en vacances chez nous. Il voulut goûter l’un puis l’autre puis l’un puis recommencer revenant sur le premier et ne souvenant plus du second qu’il fallait regoûter…
Verre après verre, il appréciait de plus en plus les deux nectars. Il avait du mal à comprendre comment, des terriens aussi en retard sur le plan technique, avaient acquis une avance aussi considérable dans ce domaine œnologique précis. Je lui expliquai le long travail de mémoire qui, depuis Noé, l’antiquité, les romains, le bon roi Henri, jusqu’à mon oncle Robert et maintenant son fils, avait abouti au produit parfait qu’il appréciait tant et qui pouvait accompagner la fameuse soupe aux choux pour laquelle René Fallet avait oublié d’indiquer la boisson.
La nuit avançait, les merles s’étaient tus et les hauteurs de Saint-Pierre LaFeuille, à l’est, commençaient à rosir. Il décida de repartir en emportant une de mes bouteilles « Domaine des Tilleuls 1985 » qui fait l’orgueil de mon Tonton et la joie de son neveu.
Je l’accompagnai jusqu’à sa soucoupe qui, malgré l’aube naissante, illuminait toute la clairière. Après un dernier signe d’adieu de son bras manipulateur robotisé, il mit le contact, tira sur le démarreur, tira sur le démarreur, … tira sur le démarreur, … agita ses antennes avec colère et dit quelque chose que je ne compris pas mais qui ne devait pas être très joli, … tira à nouveau sur le démarreur … mais rien ne vint.
Alors, et là Daniel ne me croira pas quand il me lira, mais je jure que c’est la vérité : M’arc-boutant sur le tronc d’Agar, sur les pampres de vigne et sur la gariotte en ruine, j’ai poussé son magnifique vaisseau jusqu’à ce qu’il démarre enfin dans un énorme nuage bleuté d’ozone malodorant.
Depuis cette soirée, je n’ai pas revu mon martien. Je sais qu’il reviendras’approvisionner (celui qui a goûté à nos produits ne peut pas les oublier) et que je ne le suivrai pas puisque les vignes sont dans les environs de Cahors et pas ailleurs. Je regarde souvent le ciel étoilé en pensant à lui et certains soirs il me semble y voir un point vert qui scintille.
(1) L.C.A.H.F.T. Laboratoire Central d’Approvisionnement en Humanoïdes à Flux Tendu (« just in time » pour ceux qui préfèrent)
PS : Je dédie cet amusement à Daniel SANSEIGNE, Consultant en Knowledge Management, spécialiste de la mémoire des entreprises. Avec mes amitiés. Par ailleurs, Daniel, diplômé des Eaux et Forêts est un éminent amateur de « ratafia ».
Bernard DAVIDOU Juillet 200