Cette brochure du CEP est constituée par la matière de trois causeries présentées à Gagnac par Marguerite Guély en octobre 2002 (Gagnac aux temps modernes), octobre 2003 (Gagnac au XVIème siècle) et octobre 2006 (Familles nobles et notables de Gagnac sous l’Ancien Régime), transcrites et mises en forme sous le contrôle et avec son accord par Robert Larue. Leur juxtaposition engendre quelques redites, dont le lecteur acceptera sûrement volontiers de nous excuser.
Nous y avons adjoint des annexes qui éclairent l’un ou l’autre des sujets abordés dans le texte principal. Ce sont des documents issus pour certains d’archives personnelles que des particuliers ont bien voulu mettre à la disposition du CEP, pour d’autres, de recherches effectuées aux Archives Départementales. Les éléments de généalogie concernant les familles de Lagrènerie et de Lavaur sont le fruit d’un travail considérable – dont ils ne sont qu’une toute petite partie – effectué par Guy Dauphin à partir des registres paroissiaux d’état civil sur les familles de Gagnac aux XVII et XVIIIème siècles.
Catégories Librairie : Histoire - Documents Page 14 of 20
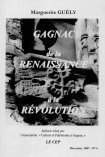
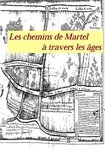
Parler des chemins de Martel à travers les âges, c ‘est aussi parler de son histoire.
Histoire de son origine tout d ‘abord, si lointaine et si controversée : l ‘étude des axes antiques qui traversent le Causse, et rejoignent la Dordogne, nous permettra de jeter quelque lumière sur la fondation de Martel.
Histoire de sa prospérité ensuite : Au Moyen Àge et jusqu ‘au XVIe siècle la ville connaît un
essor remarquable grâce à sa situation sur la route du pèlerinage de Rocamadour, la création de foires et celle d ‘un tribunal royal : la sénéchaussée dont le ressort s ‘étend sur 76 paroisses du Quercy, et qui juge en appel les causes des sénéchaussées de Turenne et de Gourdon.
Nous verrons que cette prospérité, si apparente dans les belles maisons de la ville, est également notable sur les routes, qui rayonnaient alors autour d ‘elle.
Martel s ‘endort un peu du XVIe au XVIIIe siècle, à l ‘image de toute la Vicomté de Turenne à
laquelle elle appartenait, et dont elle était en quelque sorte la capitale quercynoise.
C ‘est Louis XI qui lui porte le premier coup en créant la route de poste Paris Toulouse, par
Cressensac et Souillac, et non plus par Martel Gramat.
Le vieil axe de pèlerinage s ‘étiole et il faut attendre le XVIIIe siècle pour voir s ‘établir une
bretelle Martel Cressensac vraiment rapide.
Le second est celui de la vente de la Vicomté au Roi en 1738. Martel garde sa sénéchaussée
jusqu ‘à la Révolution, mais elle a perdu son rôle de petite capitale régionale, et doit maintenant se tourner, non plus vers un Vicomte installé à Turenne avec lequel elle a toujours entretenu des rapports difficiles, sinon proches, mais vers un intendant et une administration siégeant à Cahors et à Montauban, bien lointains et bien peu au courant des difficultés du Quercy, ex-vicomtin des bords de la Dordogne.
Le XIIIe siècle est une période où l ‘on prend, petit à petit conscience de l ‘utilité des routes pour le commerce et l ‘agriculture : Martel va le comprendre très vite et réclamer sans relâche la construction de deux routes essentielles : celle de Souillac à Aurillac, et celle de Cressensac à Gramat, qui doivent faire de la ville un croisement économique.
Sous la Révolution et l ‘Empire, l ‘État, préoccupé par les axes stratégiques, préfère s ‘occuper à entretenir la route de Souillac, qui mène à l ‘Espagne, plutôt que les routes de commerce.
C ‘est donc seulement en 1816, que commence, avec le travail des Ateliers de Charité où venait
s ’employer le trop plein des habitants de la campagne, de grands chantiers sur la RD3, Cressensac Gramat, et la RD14, Souillac Aurillac. Ils ne seront achevés, que vers 1850, alors que l ‘on met en chantier les chemins vicinaux où s ‘activeront jusqu ‘en 1939 cantonniers et gardes-champêtres.
Mais, dès 1850, l ‘ère du chemin de fer commençait et avec lui de plus vastes chantiers encore.
Après ce XIXe siècle enfiévré, qui a vu la révolution des transports, que dire de notre siècle qui s ‘achève ?
En 1931, le Conseil Municipal avait désiré que « chaque village, chaque hameau, chaque maison isolée soitreliée par un chemin carrossable au bourg de Martel « . C ‘est chose faite.
Le maire d ‘alors, M. Ramet, avait aussi souhaité, que se fasse une route des crêtes, qui aurait longé les falaises de la Dordogne, de Saint-Denis à Creysse. Belle idée touristique à une époque où voitures, autos et camions ne créaient pas encore de pollution visuelle et sonore. Félicitons-nous, que seuls les amateurs de grand air et de silence, suivent par de petits sentiers, l ‘itinéraire qu ‘il avait imaginé,et partons aussi, sur les pas de nos aïeux, le long des chemins muletiers ou charretiers, qui les conduisaient sur leurs pavés ou leurs ornières à travers toute la commune.

 A travers ce petit ouvrage, l ‘Auteur Nicolas SAVY nous invite à découvrir quelques pans de la vie des citadines du Quercy (région de Cahors), pendant les premières décennies de la guerre de Cent Ans.
A travers ce petit ouvrage, l ‘Auteur Nicolas SAVY nous invite à découvrir quelques pans de la vie des citadines du Quercy (région de Cahors), pendant les premières décennies de la guerre de Cent Ans.
Après avoir passé en revue la façon dont elles étaient perçues administrativement, il s ‘est intéressé à plusieurs aspects de leur vie quotidienne, entre leur rôle d ‘épouse, leurs activités professionnelles et la place qui était la leur dans la défense de leur ville.
Cet ouvrage ne vise pas à l ‘exhaustivité, mais livre quelques pistes données par la documentation d ‘origine urbaine de l ‘époque.
Notes sur la vie des citadines quercynoises pendant les années terribles (1345-1390).
Editions Colorys, Cahors – 85 p. – Décembre 2007
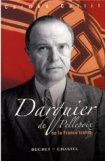
Présentation de l ‘éditeur : De collaborateur zélé des nazis, Louis Darquier de Pellepoix (Cahors 1897-Madrid 1980), souvent surnommé le » Eichmann français « , devint Commissaire général aux questions juives sous le régime de Vichy, entre mai 1942 et février 1944. Dès 1933, il avait trouvé dans un antisémitisme forcené un marchepied à son plan de carrière. Il s ‘enrichit personnellement par la spoliation et la vente des biens des Juifs arrêtés ou enfuis, et incarna jusqu ‘à la caricature une certaine droite française enracinée dans une tradition antisémite portée par Charles Maurras et défendue par Pierre Laval et Philippe Pétain. Responsable en partie de la déportation de soixante-quinze mille Juifs français vers les camps de la mort, Darquier de Pellepoix se réfugia à Madrid en 1944 où il vécut, protégé, jusqu ‘à la fin de ses jours.
Condamné à mort par contumace en décembre 1947, il vit sa peine prescrite en 1968. La France ne demanda jamais son extradition. Très jeune, cet escroc portant canne et monocle épousa Myrtle, une Australienne aussi alcoolique et mythomane qu ‘il était vantard, coureur de jupons et violent. Elle lui donna une fille, Anne, qui, abandonnée par ses parents en Angleterre, deviendra psychanalyste ; c ‘est en se rendant à sa séance d ‘analyse chez Anne Darquier que Carmen Callil apprit son décès brutal. » Certaines choses et certains individus ne méritent pas le pardon « , avait confié Anne peu avant sa mort. Cette enquête exceptionnelle, détaillée, poignante, souvent révoltante, éclaire les zones laissées dans l ‘ombre par les historiens officiels. Elle nous livre les destins croisés d ‘une jeune femme et d ‘un peuple entier, abandonnés et trahis tous deux par un père et par un homme dont la mémoire des crimes ne doit jamais sombrer dans l ‘oubli.
Biographie de l ‘auteur : Carmen Callil, Australienne née en 1938, s ‘établit en Angleterre en 1960. Fondatrice en 1972 des éditions Virago, elle fit carrière dans l ‘édition jusqu ‘en 1998, date à laquelle elle entama ses recherches sur Louis Darquier de Pellepoix, qui dureront une dizaine d ‘années. Carmen Callil vit à Londres.

Parler de Gagnac au Moyen Age est un exercice périlleux pour plusieurs raisons.
Une première difficulté tient à ce que le Moyen Age dure mille ans, et se compose de périodes très différentes. Ensuite, l’organisation politique, administrative, économique et financière est très compliquée, et changeante : c’est un mélange d’ancien droit marin et de coutumes locales. Le vocabulaire utilisé est totalement désuet et nécessite un effort de compréhension.
Il faut ajouter que le cas de Gagnac est particulièrement complexe. Est-ce bien un membre de la vicairie du Vert au temps des Carolingiens ? Est-ce réellement et toujours une paroisse de la vicomté de Turenne, jouissant de ses privilèges ? Pourquoi y-a-t’il dans cette région une poussière de petits fiefs qui révèlent soit de la vicomté, soit de la baronnie de Castelnau ?…
Toutes ces incertitudes, que nous tenterons de lever, sont probablement dues à sa situation de région frontière entre le Limousin et le Quercy, et aussi à sa proximité avec l’Auvergne. Etre à la périphérie et non au centre d’une région était et reste toujours délicat.
Une seconde difficulté tient à la longueur de l’exposé : en 500 pages, on a tout loisir de développer clairement son propos, le lecteur n’est pas obligé de tout lire d’une seule traite. En 20 pages, on simplifie tellement que les explications sont claires, mais ne rendent pas suffisamment compte de la complexité réelle des faits. Nous avons choisi une solution mixte qui n’est pas pleinement satisfaisante non plus, entrelardant des explications, des tableaux, et des exemples avec un récit continu. C’est pourquoi je conseille aux lecteurs de ne lire le texte qu’à petites doses, et munis d’une bonne carte de la région de Gagnac…Enfin, une dernière difficulté tient au style adopté : autant il est facile dans un exposé oral de rester simple afin de ne pas trop fatiguer l’auditoire, autant l’écriture exige un effort pénible pour rester exact tout en étant lisible… Les hommes savent bien que les femmes préfèrent parler plutôt qu’écrire, et que leurs propos vont dans toutes les directions ! Je demanderai donc à mes lecteurs masculins d’excuser l’apparente incohérence de mes propos, et à mes lectrices féminines de me pardonner d’être aussi ennuyeuse…
Je conclurai en invitant tous ceux qui écrivent avec plus de facilité et d’harmonie que moi à utiliser ce travail, qui n’a pour ambition que d’être une somme de renseignements, hélas peu nombreux jusque là, dont nous disposons sur Gagnac au Moyen Age.
Marguerite GUELY, décembre 2002

En 1944, des observateurs classaient le Périgord dans cette « petite Russie » en gestation où se fomentait – selon leurs analyses – la prise du pouvoir dans le Sud-Ouest libéré. C’est dire
quelle part prépondérante le système lénino-stalinien avait su conquérir, en Dordogne, depuis la constitution du parti communiste en 1920.
Dans ce département où l’emprise radicale-socialiste fut durablement représentée par Georges Bonnet, il a fallu toute la passion et l’engagement généreux de milliers de fidèles derrière un appareil dont l’idéologie dissimulait, ici et ailleurs, sectarisme, injustice et répression violente. Inspirés par les Maurice Thorez et Jacques Duclos, les chefs du Périgord, parmi lesquels Paul Bouthonnier, puis
Yves Péron, arc-boutés sur un lacis d’organisations associatives et syndicales, apprirent à s’adapter aux contingences du moment et aux attentes de groupes sociaux.
L’auteur analyse nombre d’itinéraires personnels en s’appuyant sur des sources inédites et des centaines d’entretiens avec des militants et des dirigeants du « parti des travailleurs », comme auprès d’autres témoins de la vie publique.
L’auteur :
Jean-Jacques Gillot est issu d’émigrés alliés à des périgordins ; son père fut un résistant de la France libre, à dix-sept ans. Docteur en histoire, titulaire d’une maîtrise en droit et d’un diplôme d’études politiques, il est
également officier de réserve et auditeur à l’Institut des hautes études de la Défense nationale. Après un mémoire de recherche sur la décentralisation, il a publié, avec Jacques Lagrange, deux ouvrages novateurs reconnus :
L’Épuration en Dordogne selon Doublemètre et Le Partage des milliards de la Résistance.

L ‘histoire de la vicomté de Turenne, le plus grand fief de France au milieu du XIIIème siècle, est riche de péripéties, avec entre autres le théâtre d ‘affrontements dont elle fut la victime entre Anglais et Français, et le comportement de ses suzerains qui jouèrent souvent un rôle de premier plan dans la politique du royaume.
Dans cet ouvrage, la vie quotidienne des humbles, paysans, meuniers, bergères, figure en bonne place grâce aux contes et légendes qui s ‘appuient toujours sur un fond de vérité.
Guy Maynard est né à Brive. Il a collaboré durant de longues années aux inventaires archéologiques de la Corrèze et du Lot. Il a publié plus d ‘une centaine d ‘articles dans les revues savantes de la région.
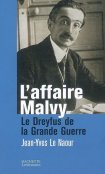
Biographie de Louis Malvy (1875-1949), ministre de l ‘Intérieur de 1914 à 1917. Les nombreuses accusations pesant contre lui (espion, toxicomane, voleur, etc.) marquent le début d ‘une campagne encouragée par Clemenceau qui avait besoin d ‘une crise politique pour prendre le pouvoir. Banni pendant cinq ans, Malvy se fera réélire triomphalement dans le Lot.
L ‘affaire Malvy :
Qui connaît Louis-Jean Malvy ? Celui qui fut pour la gauche un nouveau Dreyfus, un martyr du républicanisme est aujourd ‘hui oublié. Étoile montante du parti radical, ministre de l ‘Intérieur de 1914 à 1917 et artisan de l ‘Union sacrée, Malvy s ‘est efforcé d ‘obtenir la paix sociale dans la France en guerre en négociant avec la CGT tout en contrôlant les pacifistes plutôt qu ‘en les arrêtant. En 1917, quand la crise du moral survient, la droite nationaliste le désigne comme bouc émissaire pour expliquer tout à la fois l ‘échec du chemin des Dames, les mutineries des poilus, les grèves ouvrières et le développement du pacifisme. La Ligue royaliste d ‘Action française s ‘acharne : violeur, cocaïnomane, espion, amant de Mata Hari… les accusations les plus folles sont lancées contre le ministre qui doit démissionner sous les coups d ‘un Clemenceau exploitant cyniquement cette crise politique pour parvenir au pouvoir. Traduit en Haute Cour de justice en 1918, Malvy est condamné à cinq ans de bannissement au terme d ‘un procès inique qui constitue, pour la droite, la revanche sur l ‘affaire Dreyfus.
Dans un pays en guerre rassemblé derrière un chef pour qui la fin justifie les moyens, l ‘innocence et la justice ne pèsent pas lourd face à la raison d ‘État. À travers le récit de l ‘affaire Malvy, Jean-Yves Le Naour s ‘attaque au mythe de l ‘Union sacrée et montre comment s ‘opère le basculement à droite de la France en guerre.
Jean-Yves Le Naour est historien, spécialiste de la Première Guerre mondiale et de l’entre-deux-guerres. Il a déjà publié, chez Hachette Littératures, Le Soldat inconnu vivant (2002), La Honte noire (2004), Le Corbeau (2005), La Famille doit voter (2005) et Claire Ferchaud, la Jeanne d’Arc de la Grande Guerre (2007).

Le village de Varaire fut un carrefour de la voie romaine et du chemin de St-Jacques de Compostelle. Au XIIIe siècle, l ‘illustre famille des CARDAILLAC édifia un château dans cette baronnie. Quelques siècles plus tard vinrent les LEVIS-CAYLUS, les CASTELPERS et les LA TOUR. Des coutumes religieuses relatées dans le livre furent données en 1440. Le lieu dit Couanac qui fut rattaché à Varaire au XIXe siècle faisait partie de la seigneurie des HEBRARD et plus tard de la célèbre famille d ‘ARMAGNAC encore présente.
L ‘histoire du village est relatée jusqu ‘au début du XXe siècle.

Préface d ‘Emmanuel Le Roy Ladurie
» Il ne fait guère de doute que les historiens de toutes sortes puiseront à foison dans cet instrument polyvalent qui offre si généreusement un matériau ordonné » (Dominique Julia).
Fruit d ‘un dépouillement systématique de toutes les archives universitaires disponibles, ce Répertoire des étudiants du Midi de la France constituera pour bien des chercheurs modernistes un outil inégalé en France, et sans doute inégalable. Patrick Ferté rassemble ici plus de 40000 étudiants méridionaux (catholiques ou protestants) des 4 facultés (droits, théologie, arts et médecine), saisis sur l ‘essentiel des campus fréquentés (Toulouse, Cahors, Avignon, Montpellier, Aix, Orange, Reims, Genève et Paris) de 1561 à la Révolution. C ‘est cette envergure pluri-universitaire qui donne tout son prix à ce corpus géant puisqu ‘elle seule permet d ‘aboutir à un recensement quasi-exhaustif pour chaque diocèse et chaque lieu. Les cursus sont reconstitués et offrent un matériau unique pour une analyse fine des stratégies éducatives et de la fonction du diplôme dans la société d ‘Ancien Régime.
Une prosopographie est également amorcée : systématisée et enrichie par l ‘interactivité, elle débouche sur une histoire sociale des populations étudiantes, objectif majeur des plus captivants.
Enfin, comme l ‘université était un carrefour où se côtoyaient les » héritiers » et la petite et moyenne bourgeoisie » montante « , ce sont toutes les élites de la société d ‘Ancien Régime, actuelles ou en devenir, qui sont ainsi capturées aux filets de l ‘Alma mater et dont on peut scruter, sur 2 siècles et demi, les ressorts d ‘ascension et de reproduction.
Le présent tome 3 d ‘une série de 6 répertorie les 6200 étudiants natifs de l ‘actuel département de l ‘Aveyron (prêtres, médecins ou juristes) du 16è au 18è siècle. Il en reconstitue et analyse les parcours universitaires et, pour beaucoup, l ‘origine sociale et/ou la carrière, laïque ou cléricale.
Aux antipodes du cliché d ‘un Rouergue » inculte « , il restitue un pays exceptionnellement friand de diplômes, un des tout premiers clients des universités du royaume.
Patrick Ferté est maître de conférences d ‘histoire moderne à l ‘Université de Toulouse-Le Mirail. Spécialiste de l ‘histoire des anciennes universités méridionales, il est l ‘aueiur de plusieurs ouvrages sur ce thème et de maints articles scientifiques publiés en France et à l ‘étranger (Irlande, Espagne, Mexique, Canada, Italie…)
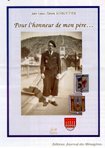
Florent, mon père, né le 24 août 1919 à Bergheim – Alsace, fusillé le 20 août 1944, au cours d ‘une épuration hâtive à Cahors dans le Lot. Il allait avoir 25 ans, il n ‘aura pas connu l ‘insouciance, le bonheur auquel il aurait eu droit.
Pourquoi Florent, l ‘humaniste, le théologien, le militant n ‘a t-il pas eu le droit de croire en ses valeurs ?
Pourquoi aura t-il fallu 60 ans et la pugnacité de son fils Jean-Louis pour faire ouvrir des archives et accéder à un document majeur et déterminant qui « casse et annule » le jugement de validation postmortem !
C ‘est de cette tragédie là dont il est question dans ce livre, complété de très nombreux documents, c ‘est de cette époque dramatique, de la détresse d ‘une femme, épouse et mère de deux enfants dont ce livre veut témoigner, au nom de la seule vérité.
En rédigeant ce livre, Jean-Louis Florent SCHROETTER a une pensée particulière pour toutes les familles qui ont vécu les affres de l ‘épuration sauvage, pour tous les laisser-pour compte qui portent à jamais les stigmates de cette souffrance.
60 ans après, chacun d ‘entre nous se sous ient et attend Reconnaissance et Honneur de l ‘État français.
Ce livre est préfacé par : Bernard RODENSTEIN, président de la Délégation Alsace de l ‘Association Nationale des Pupilles de la Nations et Orphelins de Guerre ou du Devoir (A.N.P.N.O.G.D.). Chevalier de la Légion d ‘honneur et Officier de l ‘Ordre national du mérite.
Jean-Louis Schroetter est un de ces nombreux Alsaciens qui n’a pas connu son père. Ce dernier n’a pourtant pas été enrôlé de force dans la Wehrmacht. Il n’est pas mort ou porté disparu sur tel ou tel front. Il est mort en France, à Cahors (Lot), alors que les Allemands avaient déjà fui cette ville. Florent Schroetter est natif de Bergheim (Haut-Rhin), porte un nom à consonance germanique, maîtrise la langue allemande et, de surcroît, il est membre des Chantiers de Jeunesse Française. Lorsque Cahors est libéré sans combat (« pas une chicane, pas un coup de feu ») par les FTP le 17 août 1944, tous ces éléments – auxquels il faut ajouter une lettre anonyme – font de lui un collabo en puissance. Le soir du 18 août, un camarade FTP de Florent Schroetter vient le chercher, car le Maquis avait besoin d’un interprète. Sa femme ne le reverra jamais : incarcéré le lendemain, il est fusillé en toute illégalité le 20 août. A travers la longue et difficile quête de Jean-Louis Schroetter pour retrouver les traces de son père, victime de la haine des hommes pour leurs semblables et dont « la seule présence « visible » était une grande photo, celle d’un jeune homme en uniforme, accrochée dans la salle à manger », ce livre contribue à faire connaître la situation complexe des Alsaciens pendant et après la guerre et à soulever un pan du voile qui masque toujours encore le côté obscur de la Résistance.
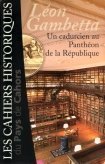
Léon Gambetta est un de ces grands personnages qui ont fait l ‘Histoire de France.
Sa mémoire est présentre dans tout le pays, mais plus particulièrement à Cahors, qui l ‘a vu naître.
Ce Cahier historique n ‘est pas une nouvelle biographie de cette célèbre figure, mais un regard porté sur quelques grands épisodes, qui ont marqué la mémoire collective, et tout particulièrement dans le Lot.
Le voyage à Cahors, le Monument aux Mobiles, la statue de Gambetta, le transfert de son coeur au Panthéon sont, par exemple, quelques uns de ces moments symboliques que cet ouvrage, croisant histoire régionale et histoire nationale, permet de découvrir ou de mieux connaître.
Ce nouveau Cahier historique d ‘attache à retrouver les mécanismes de la mémoire qui au-delà de la mort du Cadurcien, installèrent Léon Gambatta au Panthéon de la République.

Fichier « Familles de la noblesse quercinoise 16-18e s » par Jean Lartigaut (saisie Jacques Caminade)
Jean Lartigaut, décédé en novembre 2004, historien autodidacte et auteur d’une thèse remarquable sur le repeuplement du Quercy après la guerre de Cent ans (1), a fait de la généalogie à ses débuts, il était alors membre du Cercle d’Entraide généalogique de France et a publié une généalogie des Molières dans le bulletin n°3 en 1959 (2). Il a aussi à cette époque rédigé plusieurs travaux qu’il nous a confié pour publication dans Moi Géné après en avoir assuré amicalement la relecture. Il a travaillé sur les de GOZON ancêtres de son épouse et il utilisera régulièrement la généalogie dans ses travaux historiques (3). Très méthodique, il avait alors constitué ce fichier relatif à la noblesse quercinoise noté « Epoque Moderne : un peu XVIe, surtout XVII-XVIIIe s » qui vient d’être déposé par son épouse à la Sté des Etudes du Lot à Cahors. Nous croyons utile de le publier, les renseignements proviennent de multiples sources : registres paroissiaux mais aussi actes notariés déposés aux A.D. et parfois tirés de fonds privés difficiles d’accès ou que nous pensons rarement à consulter. Nos lecteurs y trouveront sûrement de précieux compléments à leurs travaux.
PhD
(1)Les campagnes du Quercy 1440-1500 ; PUM Toulouse 1978 ; rééd. augmentée par Quercy-Recherche, Cahors 2001. Nous avons tiré des fiches établies pour cet ouvrage notre Hors série n°115 (Le Repeuplement du Quercy) qui reprend les noms et lieux d’origine de centaines de colons venus s‘installer en Quercy après la guerre de Cent ans.
(2)La France Généalogique n°3 (Paris 1959) : Les origines des Molières seigneurs de la Bastidette en Quercy, 1440-1540 ; pages 53 à 61 (visible aux AD Lot). Il affinera son travail dans : L’ascension sociale d’une famille d’immigrants en Quercy au 15e s: Les Molières ; bulletin Les Annales du Midi, Toulouse 1976, p. 261-286.
(3)Note sur l’origine de la branche des Gozon de Valon établie à Thégra au 16e s ; BSEL 1955, p.126-127. Quelques notes sur la noblesse du Quercy après la guerre de Cent ans ; Actes du 21e Congrès d’études régionales Languedoc-Pyrénées-Gascogne, Toulouse 1966, p.195-208. Preuves de Malte de Jean de Gozon-Orlhonac ; Mémoires de la Sté des Lettres de l’Aveyron ; Rodez 1967, p.161-165. A propose de la famille d’Albareil, de Séniergues, en 1668 ; BSEL 1985 p.168. Les Commarque en Quercy 13-14e s ; BSEL 1986, p. 273-282. Les origines des Lefranc de Pompignan 1450-1540 ; BSEL 1985 p.19-30. Les origines de la famille Du Pouget de Nadaillacen Périgord et Quercy 1380-1500 ; L’anoblissement en France 15-18e s, théories et réalités ; MSHA Bordeaux, 1985, n°74 p.63-107. Etc.
NDLR : On se reportera à l’excellente bibliographie des travaux de J.Lartigaut publiée par Mme Hélène Duthu dans le bulletin de la Sté des Etudes du Lot de juillet 2005.
Nota : les ? figurent sur les fiches. A la saisie des sr (sieur) et sgr (seigneur) ont pu être confondus. La source signalée « Lot, salle du cadastre,… » reste inexpliquée et doit dater d’une appellation commune aux chercheurs des années soixantes… Les notaires concernés sont aujourd’hui classés dans la série 3E.
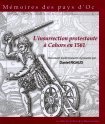
La période où se situent les événements de Cahors relatés dans ce livre est celle où le protestantisme connaît en France, et notamment dans le Midi, au sud d’une ligne La Rochelle-Lyon, une forte expansion.
Le document inédit qui est à l’origine de ce travail provient des dizaines de milliers de sacs à procès du parlement de Toulouse conservés aux Archives Départementales de la Haute-Garonne et a été trouvé en juillet 2005. Une seule pièce de ce procès nous est parvenue, intitulée « inquisition », c’est-à-dire une suite d’interrogatoires de témoins, mais elle contient tout de même 63 folios.
Les paléographes savent combien les textes du XVIème siècle sont souvent ardus à transcrire. C’est pourquoi les chercheurs, mais aussi les personnes s’intéressant à l’histoire de Cahors, du protestantisme ou tout simplement du Midi de la France, trouveront dans l’édition de ce texte qui est accompagnée d’une présentation et de notes, une description de l’état d’esprit de l’époque. Laissez-vous donc transporter en 1561…
Préface de l ‘ouvrage :
Quelle bonne nouvelle, pour l’archiviste du Lot, d’apprendre la découverte, aux Archives de la Haute-Garonne, d’un des plus anciens sacs à procès, et que celui-ci concerne le Quercy ! Qui plus est, s’il s’agit d’une affaire particulièrement importante pour l’histoire de Cahors et, plus généralement, pour l’histoire du protestantisme dans le Quercy. Certes, l’affaire était connue par les ouvrages des premiers historiens locaux, mais, à ma connaissance, les documents originaux manquaient.
Les témoignages recueillis lors de « l’inquisition » permettent d’avoir une idée de l’état d’esprit de l’époque, car les témoins racontent non seulement ce qui s’est passé le 16 novembre 1561, mais aussi plusieurs mois en arrière.
On constate ainsi que des baptêmes à la mode de Genève avaient lieu, de même que des assemblés. Plus surprenantes peut-être, les « revendications » à caractère politique des « schismatiques » ; ils ne veulent, en effet, payer aucun tribut, tailles ne emprunts au roi, ils ont le projet de se passer de la justice royale… Mais on sait bien à quel point, sous l’Ancien Régime, Eglise et royauté étaient liées.
Que Monsieur Daniel Rigaud soit remercié et félicité pour ce travail : il s’est attelé à la transcription d’un texte long, d’une écriture souvent « piégeuse », et propose aujourd’hui une édition du texte, accompagnée d’une présentation et de notes. L’ensemble sera grandement utile aux chercheurs, quercynois ou non.
Hélène Duthu-Latour
Directrice des Archives Départementales du Lot


